Littérature / édition
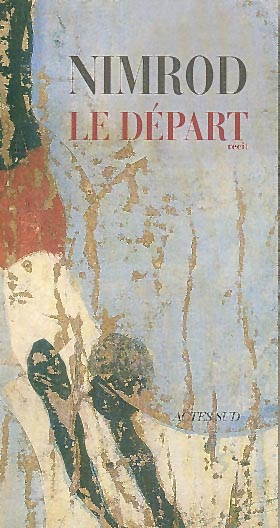
ROMAN | Février 2005
Départ (Le)
Nimrod
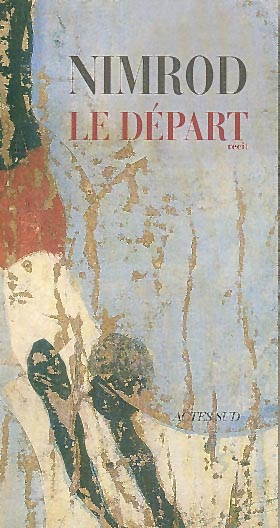
Pays concerné : Tchad
Edition : Actes Sud
Pays d’édition : France
ISBN : 274275315X
Pages: 112
Prix : 14.00
Parution : 01 Février 2005
Français
Ce récit est celui d’une enfance au Tchad.
Extrait :
» J’avais hélé Royès. Cette fois, elle daignait obéir. D’habitude, elle faisait la sourde oreille et coupait à travers les jardins, au grand dam des propriétaires. Car, pour ces derniers, avant que tombe la nuit, mieux valait veiller. Les baigneurs infatigables que nous étions déboulaient du fleuve et arrachaient carottes, laitues, navets. Royès, elle, préférait les poireaux. Forte de ses six ans, elle prenait du plaisir à provoquer comme personne. Ses formes soutenaient une énergie qui la poussait à la bagarre dès qu’un garçon de mon âge (j’avais huit ans) usait envers moi d’un mot osé, l’un de ces mots dont nous nous gargarisons, et qui constituent l’apprentissage de la virilité. Alors ma sœur – elle qui se montrait à l’ordinaire si rompue aux jeux de l’esprit – chargeait sans sommation. Cet après-midi, elle s’est gardée des luttes inutiles. Notre maison ressemble à un entrepôt qu’on installe ou que l’on vide, tant les caisses, les bibelots, les malles sont en ordre. Nous quittons Sara-de-Gaulle. En attendant le retour de ma mère (elle doit ramener une charrette pour faire enlever nos bagages), dans ma tête ne cesse de résonner le nom de Chagoua.
Tout à l’heure, au cours de la baignade, je m’étais tourné vers le pont. Il enjambe le Chari ; au fil de l’eau, une ligne sensible me relie à mon futur quartier ; une passerelle pour un destin tout neuf. Des impressions m’agitent, je ne suis pas tenu de réagir ; il m’incombe seulement de constater. A présent, l’angoisse du départ s’est transformée en désir, car il y a le pont et il y a le lointain ; il y a un bleu très ténu, il y a le gris du béton. Il y a aussi des bleus très intenses. C’est après neuf heures qu’ils se manifestent, quand le ciel densifie sa surface par un effet de glacis. Alors l’azur dessine la plus hautaine des frontières. Rien ne lui correspond mieux que le paradis qu’on nous enseigne à l’école du dimanche. Je ne lis pas encore la Bible, mais j’en connais nombre de passages par cœur. Le paradis est pour les bienheureux, pour les tout-petits – les innocents. Nous autres en sommes désormais exclus. Sauf les enfants de l’âge de Royès. Et encore. Celle-ci a l’esprit trop leste. Elle ignore, à tous les sens du terme, ce qu’est l’infini. D’un geste, elle embrasse les choses qui sont ici et celles qui sont là-bas.
J’ignore quels sont ses sentiments avant notre départ. Elle a mis sa plus belle robe et ses ballerines. Elle s’impatiente. Au sortir du fleuve, il y a peu de temps, je l’ai encore empêchée de détruire quelques pieds de poireau. Le père Rabé, assis à l’ombre des goyaviers, me remercie bruyamment. Lui aussi redoute Royès, une gamine échevelée, mais une gamine tout de même. Quand il la voit venir, le vieil homme simule la colère. Royès n’est pas dupe et le fait tourner en bourrique. Certains soirs, il contacte ma mère et lui confie : « Ta fille est une sacrée tête de mule ! » Cet homme est plutôt clément. Royès, elle, veut s’offrir le monde. Il lui suffit de tendre la main ; un jour, elle finira bien par y faire tenir l’horizon.
Je connais des lointains de toutes sortes. A sept ans, avec mon père j’ai descendu le fleuve en pirogue sur quelque trois cents kilomètres. C’est ainsi que nous sommes arrivés à Sara-de-Gaulle. Ma mère et Royès ont voyagé en voiture. De Bongor, nous avons emménagé à Fort-Lamy. J’ai contemplé des bandes de pélicans, de flamants roses, de sarcelles, de marabouts, de hérons blancs ou cendrés, de grues couronnées, de martins-pêcheurs… La présence des volatiles m’a tant diverti. Avec le recul, le calme de mon père n’en paraît que plus frappant. Il répondait à mes questions avec ferveur, une ferveur qui ne s’était infléchie qu’avec la survenue des pachydermes. Il était onze heures environ.
On se trouvait en face de Logone-Birni, une ville célèbre du Cameroun. Jadis elle a abrité les vestiges des Saos, ces géants dont l’empire s’est déployé sur les deux rives du fleuve et prolongé jusqu’au lac.
Des hippopotames, j’en avais déjà observé, de loin comme de près. Ces mammifères s’en prenaient rarement aux hommes. Sauf les solitaires : tous les pêcheurs le savent. La nuit, quand ils constatent des trous dans leurs filets, ils comprennent que le danger rôde, et se passent le mot. Sinon, les hippopotames évoluent en groupe ou en couple. Ils manifestent leur existence par une respiration bruyante. Le faisceau d’une lampe électrique de six à neuf volts suffit pour leur faire quitter les lieux. Sauf les solitaires, qui sont plutôt traîtres. Ce matin-là, à Logone-Birni, il y en avait partout. Sur la rive tchadienne et sur son banc de sable rose, des bébés hippopotames s’ébrouaient. L’étendue liquide bouillonnait littéralement. Telles des baleines, ils faisaient jaillir de puissants jets d’eau. C’était comme si tous les hippopotames du Logone s’étaient donné rendez-vous dans la crique et son eau profonde. Il n’y avait pas un mètre d’espace libre. J’en fus saisi. Je n’en avais jamais entrevu plus de deux à la fois, et d’en voir autant me bouleversa. Je questionnai mon père.
D’un coup, il avait paru ratatiné ; je compris qu’il vacillait : l’étrange troupeau ne nous laisserait pas passer. Outre ceux qui étaient sur la plage, il y en avait d’autres, incroyablement plus nombreux, qui grouillaient dans l’eau. Nous étions à présent dans le golfe et ses hautes falaises. Il était trop tard pour faire demi-tour. D’où l’embarras de mon père : il souriait sans conviction. Il s’était déjà résigné et néanmoins espérait le miracle. Triompher de la situation ou la subir : les termes du choix lui échappaient. C’est à cette minute que je lui fis la question salvatrice : « Papa, est-ce des vaches qui barbotent ? » Ses yeux brillèrent ; il me répliqua : « Oui, mon petit, ce sont des vaches ! » Et, joignant l’acte à la parole, il lança notre pirogue sur ces drôles de bovidés qui, au contact de notre rafiot, s’écartaient respectueusement, comme charmés. Par cette manœuvre, on gagnait chaque fois quelques mètres. Notre périple fut bien ralenti, car mon père évitait de les brusquer. « Elles sont bien nombreuses, les vaches ! » disais-je comme pour conjurer le mauvais sort. Pour moi, il ne faisait aucun doute : ces bêtes-là n’étaient pas des bovins. Un génie m’avait soufflé la formule pour que l’espoir ranime mon père. Bien que ne cessant pas de m’exclamer à intervalles réguliers, je finis par m’en désintéresser. Je me rappelais la peine que les pâtres se donnaient pour faire nager les vaches dans le Logone, à Billiam-Oursi, d’où nous venions. L’eau n’est pas leur élément : les mastodontes, ici, y jouent avec une aisance rare. De plus, ils se comportaient avec nous comme des toutous. De telles relations étaient forcément suspectes.
Habituellement, je regardais mon père comme un héros : je lui attribuais tous les exploits. Cette fois, je ne le fis pas. Je scrutais les dunes, les joncs, les roseaux, autant de repères grâce auxquels je notais notre progression. Je voulais m’éloigner, il me pressait d’oublier ce que je vivais. Je ne revins jamais sur notre aventure ; seul mon père l’évoque encore les larmes aux yeux.
Dix-sept ans plus tard, j’apprendrais que tel est le sens du mot horizon. Ce fut donc dans ma prime enfance que je rencontrai cette forme de la limite du monde : elle est matérielle, immatérielle – flexueuse, pour tout dire. J’habitai le pays mouvant du bleu, dont la particularité est de susciter du frais au sein du chaud, et ce sur la crête d’une ligne où celui-ci finit. Or, habiter l’horizon, c’est transgresser la borne. Frayeur que l’on ressent pour avoir enfreint une loi, la plus sacrée de toutes, la plus inviolable. Ou, plutôt, c’était comme si j’avais grandi trop vite et avais atteint la taille des géants… Un aplomb digne du ciel m’habitait enfin.
L’horizon est un appel, et nous sommes ses captifs. Au moment où notre corps se fait assez vaste pour l’intégrer, l’horizon se dérobe. Sa mobilité est fille de la transparence, une transparence propre au verbe. En fait, l’horizon n’est pas limpide, ou, plutôt, sa forme de clarté est tout intérieure. Il est sans brillance, mais en lui a lieu un rayonnement qui rappelle le nocturne – non pas celui du verre, pas même celui des neiges –, mais celui des énigmes. A l’image de ces dernières, il s’amuse à nous tenir à l’écart par une sorte de gloire immanente. Le nocturne de l’horizon est tendre et brouillé. Il est résolument distance et tient à l’être par une loi évidente et confuse. Même si nous l’atteignons d’emblée, même si, sur un plateau, il n’y a que lui pour ceindre notre front (et, par là, éteindre ou décourager toute velléité de parole en nous), l’horizon nous requiert comme par magie.
Je sais maintenant la vanité du langage. S’il nous était possible d’atteindre les choses avec l’efficacité qui opère au cœur de l’azur, la parole deviendrait inutile. L’horizon est à la fois le désir et son achèvement. C’est une place. On habite avec elle, en elle, en face d’elle. C’est le lieu total.
L’horizon n’est pas une frontière, je l’ai toujours su. Nos maisons ne peuvent avoir que lui pour vis-à-vis. Il n’était pas aussi effrayant que je l’avais cru. Pour l’instant il symbolisait le site où j’allais bientôt me réfugier loin de Sara-de-Gaulle. Mes craintes, en l’espèce, signifiaient : j’ignore le quartier où nous allons nous établir. Et j’accablais l’horizon : lui seul pouvait contenir le phénomène qui, là-haut, résonnait sous d’improbables voussures. Aux époques lointaines où mon enfance courait les routes, je dépréciais mes sensations. Je méconnaissais la race d’hommes qu’on appelle poètes. J’ignorais qu’il existât une ligne bleue des Vosges. La conquête du français viendrait plus tard, l’horizon du premier langage. »
Extrait :
» J’avais hélé Royès. Cette fois, elle daignait obéir. D’habitude, elle faisait la sourde oreille et coupait à travers les jardins, au grand dam des propriétaires. Car, pour ces derniers, avant que tombe la nuit, mieux valait veiller. Les baigneurs infatigables que nous étions déboulaient du fleuve et arrachaient carottes, laitues, navets. Royès, elle, préférait les poireaux. Forte de ses six ans, elle prenait du plaisir à provoquer comme personne. Ses formes soutenaient une énergie qui la poussait à la bagarre dès qu’un garçon de mon âge (j’avais huit ans) usait envers moi d’un mot osé, l’un de ces mots dont nous nous gargarisons, et qui constituent l’apprentissage de la virilité. Alors ma sœur – elle qui se montrait à l’ordinaire si rompue aux jeux de l’esprit – chargeait sans sommation. Cet après-midi, elle s’est gardée des luttes inutiles. Notre maison ressemble à un entrepôt qu’on installe ou que l’on vide, tant les caisses, les bibelots, les malles sont en ordre. Nous quittons Sara-de-Gaulle. En attendant le retour de ma mère (elle doit ramener une charrette pour faire enlever nos bagages), dans ma tête ne cesse de résonner le nom de Chagoua.
Tout à l’heure, au cours de la baignade, je m’étais tourné vers le pont. Il enjambe le Chari ; au fil de l’eau, une ligne sensible me relie à mon futur quartier ; une passerelle pour un destin tout neuf. Des impressions m’agitent, je ne suis pas tenu de réagir ; il m’incombe seulement de constater. A présent, l’angoisse du départ s’est transformée en désir, car il y a le pont et il y a le lointain ; il y a un bleu très ténu, il y a le gris du béton. Il y a aussi des bleus très intenses. C’est après neuf heures qu’ils se manifestent, quand le ciel densifie sa surface par un effet de glacis. Alors l’azur dessine la plus hautaine des frontières. Rien ne lui correspond mieux que le paradis qu’on nous enseigne à l’école du dimanche. Je ne lis pas encore la Bible, mais j’en connais nombre de passages par cœur. Le paradis est pour les bienheureux, pour les tout-petits – les innocents. Nous autres en sommes désormais exclus. Sauf les enfants de l’âge de Royès. Et encore. Celle-ci a l’esprit trop leste. Elle ignore, à tous les sens du terme, ce qu’est l’infini. D’un geste, elle embrasse les choses qui sont ici et celles qui sont là-bas.
J’ignore quels sont ses sentiments avant notre départ. Elle a mis sa plus belle robe et ses ballerines. Elle s’impatiente. Au sortir du fleuve, il y a peu de temps, je l’ai encore empêchée de détruire quelques pieds de poireau. Le père Rabé, assis à l’ombre des goyaviers, me remercie bruyamment. Lui aussi redoute Royès, une gamine échevelée, mais une gamine tout de même. Quand il la voit venir, le vieil homme simule la colère. Royès n’est pas dupe et le fait tourner en bourrique. Certains soirs, il contacte ma mère et lui confie : « Ta fille est une sacrée tête de mule ! » Cet homme est plutôt clément. Royès, elle, veut s’offrir le monde. Il lui suffit de tendre la main ; un jour, elle finira bien par y faire tenir l’horizon.
Je connais des lointains de toutes sortes. A sept ans, avec mon père j’ai descendu le fleuve en pirogue sur quelque trois cents kilomètres. C’est ainsi que nous sommes arrivés à Sara-de-Gaulle. Ma mère et Royès ont voyagé en voiture. De Bongor, nous avons emménagé à Fort-Lamy. J’ai contemplé des bandes de pélicans, de flamants roses, de sarcelles, de marabouts, de hérons blancs ou cendrés, de grues couronnées, de martins-pêcheurs… La présence des volatiles m’a tant diverti. Avec le recul, le calme de mon père n’en paraît que plus frappant. Il répondait à mes questions avec ferveur, une ferveur qui ne s’était infléchie qu’avec la survenue des pachydermes. Il était onze heures environ.
On se trouvait en face de Logone-Birni, une ville célèbre du Cameroun. Jadis elle a abrité les vestiges des Saos, ces géants dont l’empire s’est déployé sur les deux rives du fleuve et prolongé jusqu’au lac.
Des hippopotames, j’en avais déjà observé, de loin comme de près. Ces mammifères s’en prenaient rarement aux hommes. Sauf les solitaires : tous les pêcheurs le savent. La nuit, quand ils constatent des trous dans leurs filets, ils comprennent que le danger rôde, et se passent le mot. Sinon, les hippopotames évoluent en groupe ou en couple. Ils manifestent leur existence par une respiration bruyante. Le faisceau d’une lampe électrique de six à neuf volts suffit pour leur faire quitter les lieux. Sauf les solitaires, qui sont plutôt traîtres. Ce matin-là, à Logone-Birni, il y en avait partout. Sur la rive tchadienne et sur son banc de sable rose, des bébés hippopotames s’ébrouaient. L’étendue liquide bouillonnait littéralement. Telles des baleines, ils faisaient jaillir de puissants jets d’eau. C’était comme si tous les hippopotames du Logone s’étaient donné rendez-vous dans la crique et son eau profonde. Il n’y avait pas un mètre d’espace libre. J’en fus saisi. Je n’en avais jamais entrevu plus de deux à la fois, et d’en voir autant me bouleversa. Je questionnai mon père.
D’un coup, il avait paru ratatiné ; je compris qu’il vacillait : l’étrange troupeau ne nous laisserait pas passer. Outre ceux qui étaient sur la plage, il y en avait d’autres, incroyablement plus nombreux, qui grouillaient dans l’eau. Nous étions à présent dans le golfe et ses hautes falaises. Il était trop tard pour faire demi-tour. D’où l’embarras de mon père : il souriait sans conviction. Il s’était déjà résigné et néanmoins espérait le miracle. Triompher de la situation ou la subir : les termes du choix lui échappaient. C’est à cette minute que je lui fis la question salvatrice : « Papa, est-ce des vaches qui barbotent ? » Ses yeux brillèrent ; il me répliqua : « Oui, mon petit, ce sont des vaches ! » Et, joignant l’acte à la parole, il lança notre pirogue sur ces drôles de bovidés qui, au contact de notre rafiot, s’écartaient respectueusement, comme charmés. Par cette manœuvre, on gagnait chaque fois quelques mètres. Notre périple fut bien ralenti, car mon père évitait de les brusquer. « Elles sont bien nombreuses, les vaches ! » disais-je comme pour conjurer le mauvais sort. Pour moi, il ne faisait aucun doute : ces bêtes-là n’étaient pas des bovins. Un génie m’avait soufflé la formule pour que l’espoir ranime mon père. Bien que ne cessant pas de m’exclamer à intervalles réguliers, je finis par m’en désintéresser. Je me rappelais la peine que les pâtres se donnaient pour faire nager les vaches dans le Logone, à Billiam-Oursi, d’où nous venions. L’eau n’est pas leur élément : les mastodontes, ici, y jouent avec une aisance rare. De plus, ils se comportaient avec nous comme des toutous. De telles relations étaient forcément suspectes.
Habituellement, je regardais mon père comme un héros : je lui attribuais tous les exploits. Cette fois, je ne le fis pas. Je scrutais les dunes, les joncs, les roseaux, autant de repères grâce auxquels je notais notre progression. Je voulais m’éloigner, il me pressait d’oublier ce que je vivais. Je ne revins jamais sur notre aventure ; seul mon père l’évoque encore les larmes aux yeux.
Dix-sept ans plus tard, j’apprendrais que tel est le sens du mot horizon. Ce fut donc dans ma prime enfance que je rencontrai cette forme de la limite du monde : elle est matérielle, immatérielle – flexueuse, pour tout dire. J’habitai le pays mouvant du bleu, dont la particularité est de susciter du frais au sein du chaud, et ce sur la crête d’une ligne où celui-ci finit. Or, habiter l’horizon, c’est transgresser la borne. Frayeur que l’on ressent pour avoir enfreint une loi, la plus sacrée de toutes, la plus inviolable. Ou, plutôt, c’était comme si j’avais grandi trop vite et avais atteint la taille des géants… Un aplomb digne du ciel m’habitait enfin.
L’horizon est un appel, et nous sommes ses captifs. Au moment où notre corps se fait assez vaste pour l’intégrer, l’horizon se dérobe. Sa mobilité est fille de la transparence, une transparence propre au verbe. En fait, l’horizon n’est pas limpide, ou, plutôt, sa forme de clarté est tout intérieure. Il est sans brillance, mais en lui a lieu un rayonnement qui rappelle le nocturne – non pas celui du verre, pas même celui des neiges –, mais celui des énigmes. A l’image de ces dernières, il s’amuse à nous tenir à l’écart par une sorte de gloire immanente. Le nocturne de l’horizon est tendre et brouillé. Il est résolument distance et tient à l’être par une loi évidente et confuse. Même si nous l’atteignons d’emblée, même si, sur un plateau, il n’y a que lui pour ceindre notre front (et, par là, éteindre ou décourager toute velléité de parole en nous), l’horizon nous requiert comme par magie.
Je sais maintenant la vanité du langage. S’il nous était possible d’atteindre les choses avec l’efficacité qui opère au cœur de l’azur, la parole deviendrait inutile. L’horizon est à la fois le désir et son achèvement. C’est une place. On habite avec elle, en elle, en face d’elle. C’est le lieu total.
L’horizon n’est pas une frontière, je l’ai toujours su. Nos maisons ne peuvent avoir que lui pour vis-à-vis. Il n’était pas aussi effrayant que je l’avais cru. Pour l’instant il symbolisait le site où j’allais bientôt me réfugier loin de Sara-de-Gaulle. Mes craintes, en l’espèce, signifiaient : j’ignore le quartier où nous allons nous établir. Et j’accablais l’horizon : lui seul pouvait contenir le phénomène qui, là-haut, résonnait sous d’improbables voussures. Aux époques lointaines où mon enfance courait les routes, je dépréciais mes sensations. Je méconnaissais la race d’hommes qu’on appelle poètes. J’ignorais qu’il existât une ligne bleue des Vosges. La conquête du français viendrait plus tard, l’horizon du premier langage. »
Partager :



