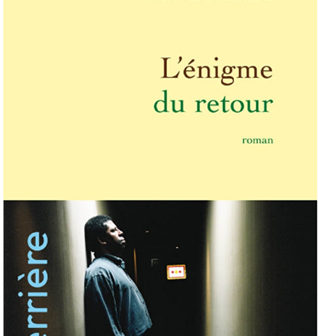Dans son dernier roman, Dany Laferrière livre un texte qui déplace les figures les plus couramment ancrées du voyage et de l’exil. On songe bien évidemment à L’Énigme de l’arrivée, de Naipaul, dont une large part est consacrée à la description de la façon dont le personnage de l’auteur parvient à se glisser dans les interstices sociaux britanniques et à s’approprier les formes de la socialité et les habitudes, ce fonds indistinct des cultures, tout en faisant en sorte qu’elles aient elles-mêmes, ces formes, le sentiment que ce sont bien ces formes et habitudes qui ont comme intégré cet être venu d’ailleurs, à leurs propres chaînes de raisonnement. L’effondrement, consécutif au vieillissement et à l’inadéquation, qu’il perçoit devient alors aussi le sien. Depuis le début de sa carrière littéraire, Dany Laferrière a justement pris le contre-pied de cette posture. Si le respect est bien cette posture exigée par ceux qui nous méprisent, alors cet auteur renvoie à ses lecteurs, irrespect du pire et déplacement du regard, qui constituent le support de cette écriture, déroulée comme son propre commentaire, qui s’enroulerait sur le bonheur d’être au monde et d’être là, comme la déclaration de la vertu absolue de ce miracle : « le simple fait d’exister ». C’est ainsi que cet auteur pose la question inactuelle du bonheur. Dans Passages, un roman un peu oublié d’Émile Ollivier, un personnage qui avait fui les ténèbres de la dictature, arrivé dans des circonstances dramatiques à Miami, déclarait pourtant son désir de retourner dans son village. Il ne fallait pas mésinterpréter ce refus d’aller de l’avant : ce qu’elle rencontrait, cette femme, était l’extinction du désir, et la morne solitude des espaces technologisés où l’architecture vaut comme agression perpétuelle. Lessentiel est toujours ailleurs : « La chose la plus subversive (
)/ c’est de tout faire pour être heureux / à la barbe du dictateur ». Cette apparente désinvolture dit la prudence, le refus de l’héroïsme et de la grandiloquence.
Pourtant, c’est bien par l’annonce de la mort du père que s’ouvre le roman. Elle ouvre l’espace d’une étrangeté à soi, même si la distance dans laquelle s’était replié le père tenait lieu de forme de la présence : il était là-bas, soudain il n’est plus. La vacance du père semble presque engager la nécessité sociale de remplir cette béance difficilement qualifiable. Il faut alors y résister : le fils n’est pas le père, que les proches tentent sans cesse de retrouver à travers lui, afin qu’il donne sens à leurs propres émotions, comme une assignation à laquelle tout deuil du père semble enjoindre. L’annonce de la disparition – les premiers mots du roman – vaut déjà pourtant pour éloge de la sobriété et de l’inflexion, comme si le personnage de l’auteur, qui a abandonné cette fois le patronyme ironique de Vieux Os, se défaisait justement de cette émotion. Elle est une invitation adressée au lecteur de se déplacer le long des représentations stéréotypées du deuil, de prendre acte par lui-même de cette profonde étrangeté aux autres, d’abord, mais à soi surtout, que l’incision du deuil imprime à l’imaginaire. Le déplacement est d’abord signalé dans la composition graphique et typographique, la coupe visible des membres de la phrase en unité de sens, en respirations. Est-ce alors une expression poétique ? Peu importe. Dany Laferrière retient l’émotion et atteint paradoxalement l’émotion la plus aiguë. La composition entière du roman est déterminée par cette apparence fragmentaire, qui tient, on l’a souvent relevé, du haïku. La césure momentanée ouvre à la suspension et à l’intériorité, à l’attention au quotidien et au passage des saisons. C’est une écriture qui se saisit de l’impalpable, le sentiment du temps, la mise à distance de la véhémence, auquel le quotidien haïtien est pourtant propice.
Il aurait eu pourtant de qui tenir : le père, homme politique populaire, maire de Port-au-Prince à 23 ans, en fut un des acteurs. Opposant actif aux dictatures de Magloire, puis de Duvalier, il a dû fuir, comme s’enfuira plus tard le fils qui ne l’a guère connu, menacé par les sbires du fils du dictateur. Le personnage de l’auteur revient longuement sur ce nud de l’histoire familiale, tentant de retrouver le fil des paroles de ce père qui a fini sa vie en quasi solitaire, dans une chambre de Brooklyn. L’histoire devient haïtienne : il y a une valise, dans une banque, léguée au fils, mais dont il ne peut se saisir, et qui viendrait d’ailleurs lui faire assumer un poids dont il sait qu’il n’est pas redevable certainement. Ce que recherche, par-delà la mort, ce fils, ce sont les traces, et sur les photographies, les gestes, les amis, les rencontres, précisément l’immatériel, qu’en lui, justement, des proches du père relèvent : une posture, une manière de se tenir. Le père est celui dont les autres lui parlent, alors qu’ils avaient dû longtemps se calfeutrer dans le mutisme. La quête se poursuit en Haïti, où il faut alors revenir. Reprendre l’attache avec le pays, tout en articulant cette agrafe à ce qui est vécu aussi dans l’ailleurs : le feu et la glace climatiques progressivement passent à l’arrière-plan. Ce qui se manifeste alors comme une évidence, c’est le scintillement de l’enfance, mais non comme nostalgie, plutôt comme une présence implicite. L’Haïtien de Montréal est peu à peu reconnu, comme lui aussi reconnaît sa propre fonction d’écrivain. Il se désaltère à la source, dans son cheminement et surtout sa disponibilité.
Celle-ci alors se manifeste aussi comme souci de la transmission, constant dans le livre : les figures du neveu, qui porte le même prénom que lui, comme lui porte celui de son père, un hommage aux absents, ou bien de l’écrivain éditeur Rodney Saint-Éloi, sont celles d’interlocuteurs privilégiés. La figure des doubles traverse ainsi tout le roman, tant dans les échanges entre personnages que dans les paysages et les situations : chaque événement est redoublé, devenant propice à un récit et à une translation et à une mise en circulation de la parole. Mais il va aussi bien au-delà de la seule velléité de succession : alors que la posture de l’écrivain est sans cesse ramenée à celle d’un désengagement politique, le regard demeure acéré, dès qu’il se porte sur le quotidien et sur la peine endurée par les êtres. L’évocation peut être brute. Mais l’image en précise le sens : « Ma mère (
) conserve dans les replis de son corps / les cristaux de douleur de tous ces gens / que je croise dans les rues depuis mon arrivée ». Le retour devient alors aussi le souvenir du départ et de la fuite. Même si l’auteur semble étranger à toute emprise de la culpabilité, les pincements se font ressentir : « Les blessures dont on a honte / ne se guérissent pas ».
La véritable question est alors celle du surplomb de l’observateur, sa posture d’écrivain, toujours nécessairement en retrait, dans un repli dont la complaisance n’est sans doute pas le pire démon : le corps a changé car le régime alimentaire désormais est celui de l’abondance. Le corps haïtien, lui, frémit sous la menace quotidienne, et vibre de la recherche de sa subsistance, comme le constate l’auteur : « je me sens mal à regarder ma ville / du balcon d’un hôtel ». C’est une expérience que connaissent tous ceux qui se rendent en Haïti. Il faut dépasser la peur, et se laisser porter par ce qui ne saurait s’interpréter qu’à partir des schémas acquis là-bas. L’auteur, guidé par Le Cahier d’un retour au pays natal, de Césaire, va alors, sans la nommer explicitement, mener sa propre décolonisation. Il va suivre les êtres, s’asseoir à côté d’eux, écouter, accepter ces signes qui, en Haïti, ne sont pas des formes, mais bien des forces. Ce qui prend l’allure de la plus grande déprise devient alors le véritable retour vers les origines, vers le village du père et la rencontre au plus profond de ce qui fonde la culture. C’est elle, la véritable énigme : l’impossibilité maintenue de nommer ce dont on fait partie. Si je décris les formes d’une culture, c’est bien que j’en suis sur le pas de la porte. En se déprenant de toute velléité explicative, de toute tentation de repossession, l’auteur voit alors le surplomb se désagréger et même perdre sa raison d’être. Le temps de l’enfance revient enfin, sans contrainte. Le corps se déplie et s’accomplit comme la monture des dieux. Et ces dieux-là, même si les discours des sciences humaines ne cessent de les ramener à l’entendement, il faut enfin en convenir, ne sont les cousins de personnes. Ce sont des dieux. La terre haïtienne n’est plus oubliée des hommes : elle vibre de ses chants multiples, d’une rare élégance, si délicate à qui veut bien l’écouter.
C’est aussi de cette façon que se manifeste une des plus subtiles intuitions de l’auteur : dans la peinture haïtienne, il s’avère que le point de fuite de la perspective n’est pas inscrit dans le tableau, mais bien devant lui, dans le plexus solaire de son spectateur, comme une perspective inverse. C’est peu de souligner aussi que l’auteur parvient de manière analogue à atteindre son lecteur, en soulignant sans cesse qu’il est en train de lire une réalité à laquelle, lui aussi, donne sens, et sans aucun doute, participe.