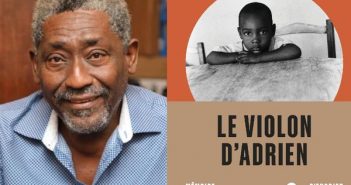Un regard de Valérie John, plasticienne, sur la Martinique, son espace de vie et de création. Elle nous propose de tirer le fil de ce qu’elle nomme les « hors lieux », qui seraient définies par trois parties : La mémoire, l’échouage, l’histoire de l’art du lieu, L’Atelier-mémoire-plastique et L’Atelier de l’artiste le lieu de la matière transformée.
« Je suis né dans une île amoureuse du vent
où l’air à des odeurs de sucre et de vanille… » Daniel Thaly
« Adieu Foulards »
« Nous ne chanterons plus ces défuntes romances
que soupiraient jadis les doudous de miel…. » Guy Tirolien
» Toutes cultures humaines ont connu un classicisme, une aire de certitude dogmatique, qu’elles devront désormais dépasser ensemble. Et toutes les cultures, à un moment ou à un autre de leur développement, ont ménagé contre cette certitude des dérèglements baroques par lesquels, à chaque fois, ce dépassement fut prophétisé en même temps que rendu possible » Edouard Glissant
L’histoire, elle commence dans l’horreur du bateau négrier. Des habitations se sont implantées; on a besoin de bras. Les Caraïbe, premiers habitants des îles sous le vent, ont été décimés. Les survivants ont préféré le suicide au travail forcé des champs de « canamelles », nom ancien de la canne à sucre. Une légende porte souvenirs de leurs sauts héroïques du haut des grandes falaises. Les engagés blancs affectés à l’exploitation des terres défrichées s’étaient vus foudroyés par les fièvres, le soleil, la malnutrition, les maladies. II fallait trouver des « créatures » habituées aux chaleurs d’un climat similaire. Ce fut la traite, plus de cinquante millions de personnes, arrachées à leur terre, entassées dans les cales de navires, précipitées dans les soutes innommables du projectile occidental. Pour le sucre colonial, on inventa « le nègre ».
Notre histoire commence ainsi
Ils ont abouti en un lieu sans l’avoir vraiment désiré
J’entends encore ce cri
Ce cri de douleur, ce cri de l’arrachement, de la perte de soi et des siens. Ce cri poussé quand on l’a mis en calle. Il y a donc une première mémoire à retrouver. Elle est issue de la traite. Elle commence sur le bateau négrier. La calle est réservée à l’entassement d’esclaves enchaînés deux à deux. Des « tombes flottantes », disait-on de ces navires(1), car le voyage est long de nombreux esclaves périssaient avant de parvenir à la Martinique. Mal nourris, ils sont soumis à toutes sortes de sévices lors des tentatives de rébellion. L’arrachement à leur famille et à leur lignage, une nouvelle identité par le baptême tout conspire à mettre entre parenthèses la culture africaine. Quand ils sont distribués sur les plantations, dans les ateliers et les cases, on procède systématiquement au mélange des ethnies ; l’esclave doit en effet perdre la mémoire de ses origines. L’esclave dépouillé de son humanité, peut alors vivre dans la soumission totale.
Faire mémoire pour que s’instaure en nous l’humain. Faire humain est indissociable de la mémoire et en conséquence à son rapport à l’histoire. Faire mémoire pour arriver à vaincre la fatalité de l’origine perdue. Arriver à recréer une terre d’accueil à partir d’une émigration forcée au lieu même de l’exil et de la déportation. Se défendre contre le mémoriel. Car s’il s’agit de faire c’est l’avenir qui est concerné. Arriver à s’enraciner en un lieu. Par cela prendre la place d’une vielle fileuse créole oeuvrant sur ce que René Depestre définit comme le « métier à métisser« (2).
Etre de ceux qui savent que « toute culture est métisse au sens ou elle se partage nécessairement entre le mythe et la réalité et d’autre part, se vit à la foi au passé et au présent « (3). Le présent vient à nourrir le passé, le passé nourrir le présent. Comprendre « dans l’aujourd’hui ce qui s’est fait « (4). Se rendre compte que « l’ancien le plus ancien peut accéder à la modernité : il suffit qu’il se présente comme la négation de la tradition et qu’il nous en propose une autre. Paré des mêmes pouvoirs polémiques que le nouveau, le très ancien n’est pas un passé : c’est un commencement« (5).
Refuser d’être prisonnier de l’histoire de sa prison et avec sa part de liberté, d’imagination, témoigner pour cette originelle communauté, projetée de la mort à la vitalité présente ; montrer qu’on peut bâtir, à partir d’une fragilité en sentinelle, une destinée de dignité. Et Simone Schwarz Bart, par la bouche de la vielle Télumée-Miracle de dire : « le pays dépend bien souvent du cur de l’homme : il est minuscule si le cur est petit, et immense si le cur est grand. Je n’ai jamais souffert de l’exiguïté de mon pays, sans pour autant prétendre que j’ai un grand cur. Si on m’en donnait le pouvoir, c’est ici même, en Guadeloupe, que je choisirais de renaître, souffrir et mourir. Pourtant, il n’y à guère, mes ancêtres furent esclaves en cette île à volcans, à cyclones, à moustiques, à mauvaise mentalité. Mais je ne suis pas venue sur terre pour soupeser la tristesse du monde. A cela, je préfère rêver, encore et encore, debout au milieu de mon jardin, comme le font les vielles de mon age, jusqu’à ce que la mort me prenne dans mon rêve, avec toute ma joie
»
Tenter de récupérer le passé afin de retrouver les racines. La racine cette partie des végétaux qui les fixe au sol et par où ils puisent les matières nécessaires à leur nutrition. C’est donc ce qui vient de terre.
Elle est le lieu de la naissance. La racine est « le point de départ, le commencement absolu à partir duquel le mouvement se déclenche« . Elle se pose comme l’origine, et permet à d’autre d’apparaître. Ne dit-on pas prendre racine quand on se fixe en un lieu ?
Faire mémoire c’est travailler chez les morts dans les profondeurs de la terre, de la calle. S’enraciner alors dans un magma obscur.
En effet, « elle est à la fois force de maintient et force ténébrante. Aux confins de deux mondes, de l’air et de la terre, l’image de la racine s’anime d’une manière paradoxale dans deux directions selon qu’on rêve à une racine qui porte au ciel les sucs de la terre ou qu’on rêve à une racine qui travaille chez les morts, pour les morts« .
« Maintenant nous savons que nous sommes créole. ( ) un mélange mouvant, dont le point de départ est un abîme et dont l’évolution demeure imprévisible. De par le monde ce processus que nous vivons depuis trois siècles se répand, s’accélère : peuples, langues, nation se touchent et se traversent par une infinité de réseaux que les drapeaux ignorent ( ) Le monde se met à résonner de sa totalité dans chacun de ses lieux particuliers. Il nous faut désormais tenter de l’appréhender, loin du risque appauvrissant de l’universalité dans la richesse éclaté, mais harmonieuse d’une diversalité « .
Etre créole
A quelle histoire, à quelle pensée s’accrocher. Sur quels rivages échouer.
Continuer ou rompre. Il faut ruser ; être métis ; favoriser la diversité, une pensée adventive agissant au gré de divers tropismes liés à des rencontres imprévues. « Multiple et polymorphe, connaissance oblique et intelligence conjecturale, la métis s’applique à des réalités mouvantes qui ne se prêtent ni à la mesure précise ni au raisonnement rigoureux « . Elle déborde. Repoussant les limites du lieu. C’est cette montée qui permet de rompre, et donc de continuer. « Tout élément cherche à déborder ses limites pour tendre vers un autre et le rejoindre, dans une constance dynamique de décentrement de débordement« .
S’il nous faut parler du passé, lui permettre de s’inscrire dans un coin de notre mémoire et travailler dans les contours de ce paysage personnel, la mémoire c’est aussi la faculté d’oublier. Si on n’oubliait pas on ne serait pas capable d’avoir un avenir et de vivre.
Nous avons une mémoire inscrite à la naissance, celle qui nous permet d’être singuliers. Celle qui nous fait différent des autres, un corps, un sexe, un endroit où nous sommes nés. C’est l’histoire personnelle. Ensuite nous avons la situation historique que nous mettons en commun avec celle de nos contemporains. Et en fin, l’entrecroisement, comme sur un métier à tisser où la mémoire historique et personnelle se trame. Pourrait-on imaginer que les pratiques, les traditions relèveraient d’une totalité qui les préserverait toutes. Ainsi des résurgences de la part infernale du monde créole, de cette matrice longtemps étouffée, méprisée, retenue, va s’élever la clameur d’une identité. Toute la nécessaire violence de son affirmation se dit dans « Tropiques », une revue littéraire, dans laquelle, dès 1941, Aimé Césaire réunit les textes de ses amis dans l’esprit d’un slogan décapant : « la poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas
»
Il nous faut obligatoirement recoudre, retisser, retrouver la source esthétique.
La conscience de soi se construit, tourmentée des mémoires multiples. De ceux qui se sont enfuis et qui ont amené leur silence dans les mornes. De l’Afrique, « ils cultivent une songerie immobile « . A l’abolition « ils ajouteront au phénomène de créolisation la poétique d’une Afrique souvenir mythique et idéelle « .
Les esclaves eux ne sont que des africains déportés ceux là doivent réinventer la vie. Ceux qu’Edouard Glissant appelle « les migrants nus « . Ceux dont le bagage se résume à des traces nébuleuses dans le repli de la mémoire. Nous sommes face à une mémoire fuyante, à conserver, une histoire éclatée à retenir, à restaurer.
Qui est l’héritier du cri ? Celui qui sera capable de passer du cri à la parole, capable de se transformer en « artiste du cri « . Le conteur, le paroleur, « le papa-langue de l’oralité d’une culture naissante« . « Le conteur est, dans sa parole et dans ses stratégies, riche de l’Amérique précolombienne, de l’Afrique, et de l’europe. Il est déjà créole – c’est-à-dire multiple, déjà mosaïque, déjà imprévisible « . C’est celui qui en plein cur des champs et sucreries reprendra à son compte la contestation de l’ordre colonial utilisant son art comme masque et didactique. « Le jour, il vit dans la crainte, la révolte ravalée, le détour appliqué. Mais la nuit, une force obscure l’habite. Une levée atavique brise la carapace sous laquelle il s’embusque. D’insignifiant il s’érige mitan des cases à nègres, maitre-pièce de la mécanique des contes, des titimes, des proverbes, des chansons, des comptines qu’il élève en littérature, ou plus exactement en oralitude « . L’oraliture créole instaure le lieu de marronnage dedans l’habitation. Cette pratique semble être l’esthétique du choc de nos consciences. Cette esthétique va s’affronter aux valeurs du système colonial et répandre subrepticement de multiples contre valeurs, une contre culture. Si cette langue du conteur réfléchi dans ses phrases la diversité du monde ; être langue écho-monde
Histoire de l’art et héritage
Ne devrions-nous pas être les héritiers de tout cela ?
Les héritiers d’une histoire de l’art de la Martinique, depuis 1945 entre en résonance avec celle du politique, des comportements et des mentalités. Ce demi-siècle semble marqué par la séparation du monde en bloc, par la décolonisation et par la « mondialisation » d’une part, et par l’avènement d’une consommation de masse, la libération des murs, la revendication culturelle des minorités et l’affirmation de l’individu d’autre part. Notre histoire du lieu, la Martinique, n’est pas fondée sur une tradition et une évolution culturelle continue. L’art en Martinique se présente comme le produit d’un affrontement entre les représentations occidentales et les valeurs culturelles non européennes. Ces valeurs importées d’Afrique ; les propositions culturelles engendrées par les esclaves sur les habitations ; les circulations indiennes et asiatiques ; travaillent à l’émergence, à la construction, à la permanence d’une culture singulière, d’un réel martiniquais, d’une identité.
Notre histoire commence par une perte.
Cette perte commence après la destruction des civilisations amérindiennes, avec la répression sur les plantations des traditions culturelles et cultuelles importées d’Afrique par les esclaves, complétée par l’uvre d’évangélisation des missionnaires chrétiens. L’esclavage a mis fin à leur activité créatrice et la période esclavagiste est restée stérile à toute création picturale et sculpturale. Cependant l’esclave n’est pas resté un être passif. Il va cacher au plus profond de lui ces racines Africaines, il les fera ressurgir sous la forme de contes et de mythes dans lesquels l’homme africain est libre. Il va grâce à cela se construire des repères culturels et symboliques. « Les nègres d’Afrique comme l’écrit Dany Bédel-Gisler dans Le réel canne dans l’imaginaire guadeloupéen vont s’adapter et adapter leurs langues et leurs cultures premières au système de référence colonial qui avait brusquement pris la place des systèmes africains. Ils vont mobiliser toutes leurs forces pour s’organiser collectivement en fonction du présent et du passé, pour créer une langue, le créole, élaborer un rapport propre au corps, bref, conférer par une volonté de cohésion et d’unité, un sens à ce monde imposé, donner naissance à une culture« .
Après l’abolition, et malgré l’abolition la prépondérance de la culture européenne demeure. Selon Jean Bernabé, Patrik Chamoiseau, Raphael Confiant dans éloge de la créolité « Notre vérité s’est trouvée mise sous verrou ; à l’en-bas du plus profond de nous-mêmes, étrangère à notre conscience et à la lecture librement artistique du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes fondamentalement frappés d’extériorité. Cela depuis les temps de l’antan jusqu’au jour d’aujourd’hui. Nous avons vu le monde à travers le filtre des valeurs occidentales, et notre fondement s’est « exotisé » par la vision française que nous avons dû adopter. Condition terrible que celle de percevoir son architecture intérieure, son monde, les instants de ses jours, ses valeurs propres, avec le regard de l’autre. Surdéterminés tout du long, en histoire, en vie quotidienne, en idéaux (même progressistes), dans une attrape de dépendance culturelle, de dépendance politique, de dépendance économique, nous avons été déportés de nous-mêmes à chaque pan de notre histoire scripturale, picturale et sculpturale« .
Si les écrivains ont pris très tôt parti pour les colonisés, l’autonomie des pratiques plastiques a été plus tardive. « En 1936, le père Delaware observait qu’aucune création originale, picturale ou sculpturale, n’existait en Martinique« , même si dès les années 30 et 40 il y a déjà une prise de conscience de ce que nous sommes. Dès lors se manifeste une volonté d’assumer notre histoire, en même temps de dénoncer le rôle tragique de l’assimilation sur l’histoire culturelle de ce pays.
En 1932, un pas est franchit avec la publication de la revue légitime défense par un groupe de martiniquais, on y dénonce la condition sociale et économique des travailleurs noirs antillais ; on y affirme l’existence d’une culture noire ; on y fait l’apologie de la production artistique du monde noire, on y parle de jazz noir américain, d’art populaire africain, d’uvres littéraires afro-américaines. Cela montre bien que nous sommes un peuple jeune ; que notre histoire de l’art ne peut que l’être aussi. L’histoire de l’art du lieu commence véritablement après la seconde guerre mondiale. C’est à ce moment que l’on peut noter le développement d’un art qui prend en compte la réalité des lieux.
C’est à partir de cette date 1945, que le fil de l’histoire se délie.
L’atelier 45 ; ce groupe né en 1943 remet en question l’exotisme. Ce groupe se compose de messieurs : Honorien, Myrtille, Tiquant, ils sont les anciens élèves d’artistes européens immobilisés en Martinique pendant la guerre qui ont pour noms Denusière, Baldjean, Hibran, Lepage. Leur ambition : être soi-même dans son pays. Il y a chez ces artistes la conscience que l’art martiniquais est à créer et que le faire exister, c’est se doter d’une arme fondamentale pour un affranchissement véritable et définitif.
[Cela met en évidence le fait que notre histoire commence quand le paysage de l’art occidental change du tout au tout.
De 1945 à 1995 on passe d’un monde de l’art dont le rayonnement est bien circonscrit par la compartimentation de la guerre froide, à un monde pluraliste, et multiculturel, la mondialisation touche aussi l’art.
En 1947 naît l’Inde indépendante
Le premier conflit vietnamien
En 1960 l’empire colonial français disparaît avec l’accession des pays africains à l’indépendance.
En 1962, on assiste à la décolonisation de l’Afrique du Nord, avec l’indépendance de l’Algérie. Ce processus de décolonisation coïncide avec l’avènement des temps postmodernes. On assiste à un changement.
Il apparaît rétrospectivement que les années 1968-1970 auront été des années cruciales de basculement].
En Martinique, les années 60 voient l’apparition d’artistes portés par le désir de légitimer leurs racines, et de nouer à la question de l’identité une recherche plastique où s’impose une double volonté d’avoir une nécessaire distance avec la France et de déchirer le voile jeté sur les attaches africaines de l’Antillais, pour réhabiliter ce que nous tenons de l’Afrique. La nouvelle conscience de soi déjà présente dans la littérature et la poésie s’affirme peu à peu dans la peinture. On voit l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes plasticiens marqués par la problématique de la négritude. Le terme négritude si l’on se fie à la définition de Léon Gontran Damas serait que le noir chercherait à se connaître, qu’il souhaiterait devenir un acteur culturel et non point simplement un objet de domination ou consommateur de culture. L’antillais veut se réapproprier sa part nègre. Des artistes iront au bout de ce voyage, au contact de l’Afrique. Nous sommes dans les années 1970.
Ils sont trois : Serge Hélénon, Louis Laouchez, et Gensin (celui ci n’ayant appartenu que très peu de temps au mouvement). Ils fondent l’Ecole Négro – Caraïbe. Leur projet créer au plus près de la réalité et du réel martiniquais nourrit par l’idée que l’art martiniquais doit conquérir sa dignité d’art en prenant pour son propre compte ce qui est le propre de l’art : un travail qui remplace la réalité subie par la réalité entièrement désirée.
Serge Hélénon dit : « on nous a imposé comme outil la culture occidentale mais notre manière de penser n’a jamais été tout à fait en connivence avec cette culture imposée. On nous a obligés à ignorer notre histoire. Nous sommes un peuple qui va à la recherche de sa Vérité intérieure. En tant qu’artiste, j’ai trouvé une sorte de mission qui est de retrouver les sources occultées, secrètes, pour les faire revivre (
) notre combat est de retrouver notre authenticité, de faire valoir notre identité, de la montrer « .
Chacun des trois peintres poursuit cette recherche, aujourd’hui séparément, à Abidjan, à Nice et à Fort-de-France.
En Martinique, quelques année après précisément en 1984 six artistes se regroupent pour fonder le groupe Fwomajé Victor Anicet, Bertin Nivor, François Charles-Edouard, René Louise, Yves Jean-François et Ernest Breleur. Ils posent le problème d’une pratique en relation avec leur milieu et souhaitent explorer toutes les composantes de celui ci. Ils s’engagent dans la mise en uvre pour une esthétique caribéenne. L’époque est à la contestation, à l’engagement politique et existentiel.
Sur le vieux continent les mêmes problèmes existent. Comme d’autres, les artistes mettent en cause leurs héritages. Ils tentent de se débarrasser des leçons, ils mêlent militantisme politique et engagement artistique.
L’objet artistique doit supporter des tensions contradictoires.
Le matériau.
Le concept.
L’attitude artistique.
Le corps de l’artiste.
Le milieu d’existence de l’uvre, ses conditions sociales de réception.
La notion d’artiste elle-même s’en voit renouvelée.
Nous assistons alors à la pluralité des formes d’expressions.
Le peintre et le sculpteur se voient rejoints par le chaman, le sorcier, le performer, l’actionniste, le conceptuel, le minimaliste
En dépit des facteurs d’homogénéisation internationale, les diverses cultures font valoir leurs différences.
1989 Ernest Breleur quitte le Groupe Fwomager.
Peut on parler d’une air nouvelle ; d’un positionnement autre.
Comme l’écrit Priscat Dégras dans sont texte dont le titre est Edouard Glissant : La pensée archipélique « Il s’agira donc de ne pas s’arc-bouter à cette seule singularité de souffrance, à ce gouffre premier dont le vertige, toujours aussi vif, droit être dépassé afin qu’il soit possible d’aller, s’il se peut, au- delà de l’enfermement et des impossibilités conjuguées de l’histoire. Il faudra se garder, de la manière la plus vigilante, de cette autre contrainte : celle d’un enracinement identitaire exclusif. Contre ce péril, la pensée de la trace s’oppose à l’enfermement identitaire. La pensée de la trace est une résistance aux défaillances de la mémoire collective et individuelle. » Edouard Glissant à ce propos écrit ceci : « la trace, c’est la manière opaque d’apprendre la branche et le vent : être soi, dérivé à l’autre. C’est le sable en vrai désordre de l’utopie.
La pensée de la trace permet d’aller au loin des étranglements de système.
Elle réfute par là tout comble de possession. Elle fêle du temps. Elle ouvre sur des temps diffractés que les humanités d’aujourd’hui multiplient entre elles, par conflit et merveilles.
Elle est l’errance violente de la pensée qu’on partage. »
L’artiste Martiniquais d’aujourd’hui qui est-il ?
Il sait que d’autres avant lui ont tracé des chemins, doit-il les emprunter ? Doit-il les occulter ?
Je prends le parti de parler à la première personne du singulier. Car c’est sous le couvert de ma pratique que je me permets d’avancer certains propos.
Tout individu a besoin d’effectuer des rites de passage, de faire ses humanités, en Afrique on dirait passer par la case de l’homme. Cette case de l’homme quelle est-elle ?
Elle est le lieu où il pourra se construire une identité particulière et singulière. Pour l’artiste cette identité singulière est très importante. Elle lui permet de charger sa pratique de ce qu’il est. Un individu de qui veut que sa pratique donne à voir ce qu’il charrie de plus personnel et si cela rencontre le monde c’est très bien.
L’artiste veut être un arpenteur, toujours à la recherche de quelque chose, mais c’est de lui qu’il parle indirectement. Il veut être errant. Seul sa pratique est son territoire ; elle le territorialise et le déterritorialise à la fois.
Un territoire qui n’en est pas un, car il est fluctuant, en déplacement, surprenant, c’est la terre de l’errance, cette terre où l’on rencontre l’imprévisible, l’incertain, c’est l’errance qui ouvre le champ des possibles.
Dans la préface au Cahier d’un retour au pays natal, André Breton écrit : « tout grand art vaut au plus haut point par le pouvoir de transmutation qu’il met en uvre et qui consiste, à partir des matériaux les plus déconsidérés, parmi lesquels il faut compter les laideurs et les servitudes, à produire on sait assez que ce n’est pas l’or de pierre philosophale mais bien la liberté « .
Il n’y aurait plus ni centre, ni périphérie, ni dominant, ni dominé, mais la pratique.
///Article N° : 13465