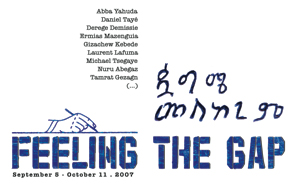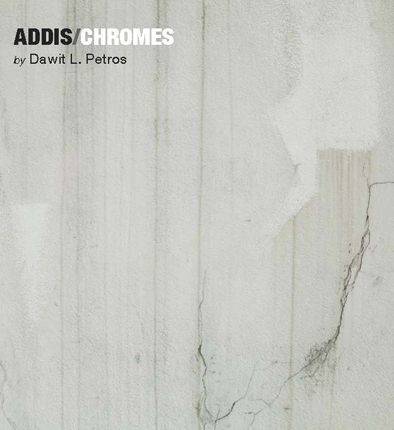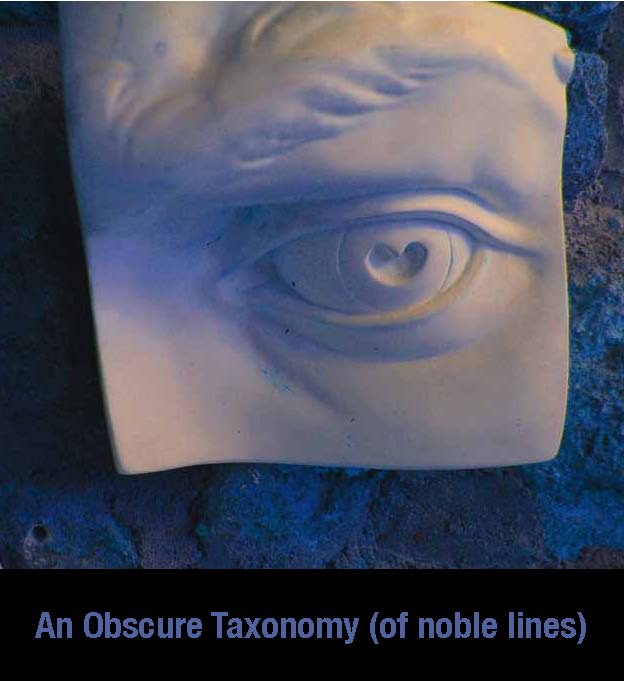À l’occasion de l’exposition Face2Face qui vient de se clore à Addis-Abeba, Leo Léfort, galeriste très actif, nous a fait part du travail qu’il accomplit dans la capitale éthiopienne où il est installé depuis plus de dix ans. Au cours de cet entretien, il revient sur son parcours intellectuel et aborde la question des traditions artistiques en cours dans ce pays. Puis, il esquisse une topographie des galeries et lieux d’art qu’il a contribué à créer durant ces dernières années à Addis-Abeba. Enfin, il retrace un historique des dernières expositions réalisées au cours de l’année 2011 à la galerie Atelier. Ce faisant, Léo Lefort nous fait pénétrer dans un laboratoire stimulant de conception d’expositions à proprement parler : différentes thématiques y sont finement explorées, donnant lieu à un riche tissu d’expériences, références et échos qui se correspondent et s’enrichissent mutuellement. Enfin, ses propos ne manquent pas d’évoquer les démarches d’une poignée d’artistes passionnants, dont certains sont encore peu connus en dehors des confins éthiopiens.
Vous travaillez depuis une dizaine d’années à promouvoir les artistes contemporains éthiopiens à Addis-Abeba et à l’étranger. Pouvez-vous à la fois retracer votre propre parcours et nous expliquer comment, de votre point de vue, la situation a évolué dans le domaine de l’art contemporain en Éthiopie pendant ce laps de temps ?
J’ai un parcours plutôt classique qui m’a conduit à l’obtention d’une maîtrise en arts plastiques à l’Université Rennes 2, en Bretagne. En licence, j’ai saisi l’opportunité d’intégrer l’atelier estampe pour y enseigner la sérigraphie. Cette technique m’intéressait énormément parce qu’elle offrait de nombreuses possibilités en termes de diffusion. Dans ma jeunesse, j’avais bénéficié très tôt d’une expérience d’investissement de l’espace public en mettant en place des ateliers de sérigraphie en milieu rural, dans les écoles ou lors d’événements « populaires ». Cette méthode relativement simple de production d’images me permettait d’allier une recherche purement « graphique » à une dimension « politique » d’un travail qui s’inscrivait dans un environnement urbain (à travers des affiches, des flyers, des productions vestimentaires) tout en m’offrant la possibilité de collaborer ponctuellement avec d’autres personnes comme des étudiants, des groupes de musique ou des militants de tous poils. À cette époque, l’esprit de la Factory d’Andy Warhol et des Velvet Undeground me fascinait. À la faveur d’un stage réalisé dans le cadre de ma maîtrise, je me suis retrouvé enrôlé au domaine de Kerguéhennec. Ce centre d’art contemporain situé en Bretagne était alors dirigé par le commissaire et critique d’art Denys Zacharopoulos qui m’a pris sous son aile et avec lequel je collabore encore aujourd’hui. À l’époque, il m’a offert l’opportunité de bénéficier d’un atelier au cur du centre qui m’a permis de sortir du champ de l’estampe dans lequel je risquais d’enfermer ma pratique. J’ai ainsi pu explorer le dessin et la sculpture et me consacrer pleinement à ces activités pendant deux années. Je me suis nourri de cet environnement exceptionnel au sein duquel j’ai eu l’occasion de travailler avec des artistes tels que Pier Paolo Calzolari, Yves Oppenheim ou encore John Millei. J’y ai également rencontré des personnes issues du monde du théâtre (Christian Rizzo), de la danse (Emmanuelle Huynh) et de la musique (Michael Levinas), pour n’en citer que quelques-uns
Ce côté pluridisciplinaire m’a toujours intéressé et, dans ce lieu ouvert aux résidences, il n’y avait pas la pression d’une obligation de résultat. L’éventuel succès n’était perçu que comme un effet secondaire par rapport à la production, mais ce n’était en aucun cas un objectif à atteindre. Je m’occupais également de la médiation culturelle tout en développant ma pratique personnelle au sein d’un atelier : je bénéficiais ainsi de conditions extraordinaires, plongé au cur d’un environnement réellement féerique. Il faut en effet imaginer l’immense parc de sculptures contemporaines, les étangs, la ferme, les écuries, la bergerie et le domaine du XVIIIe siècle. Au terme de cette expérience, avec en point d’orgue la soutenance de ma maîtrise, il m’a alors fallu trouver une solution pour résoudre le « problème » du service militaire. Ma candidature à un poste de coopérant au service national ayant été acceptée, j’ai été affecté à l’Alliance française d’Addis-Abeba. Le directeur de l’époque, Alain Thomas, revenait d’un poste en Inde. Aux yeux de ce féru de danse, la médiation culturelle constituait un aspect très important de notre fonction. Autant que je me souvienne, c’est l’un des fondateurs des premières Maisons de la Culture, avec Catherine Tasca, du côté de Montpellier. Il m’a introduit dans le monde de la diplomatie culturelle, qui était complètement nouveau pour moi et, en même temps, il m’a donné carte blanche pour la conception et la mise en place des expositions. En échange de cette liberté, il souhaitait que j’en organise une toutes les deux semaines ! Il a alors fallu que je m’immerge totalement et immédiatement dans le milieu de l’art contemporain éthiopien. Au départ, cela ne fut pas chose aisée parce que j’étais issu d’une culture dans laquelle la peinture était bien évidemment présente sans toutefois être vraiment au cur des pratiques contemporaines. À l’inverse, en Éthiopie, 80 % des artistes – si ce n’est plus – étaient à l’époque des peintres qui avaient reçu une formation ultra-académique. Ce fut alors une « grande de claque » pour moi et, en même temps, une expérience véritablement passionnante qui me permettait de remettre en question la notion même de contemporanéité et les modalités de production des images au XXIe siècle en les contextualisant dans un autre système, « excentrique », pour le coup.
Nous avions aussi l’opportunité de recevoir des expositions prestigieuses, grâce aux tournées internationales du réseau AFAA (Association Française d’Action Artistique, ancêtre de l’actuel Institut Français). Je me souviens de celle qui venait de l’Institut français de Johannesbourg et qui était constituée de gravures de Redon, Chagall, Braque et Picasso. Pour faire face à cette proposition, il m’était apparu opportun et quasi indispensable d’associer le contrepoint éthiopien, en présentant les uvres sur papier du graphiste et sérigraphiste Abdourahman Sheriff, qui fut le directeur de l’École des Beaux-arts d’Addis-Abeba pendant une vingtaine d’années et qui avait été formé à Berlin dans les années soixante.
Nous avions également organisé deux expositions de photographies dont l’une, Regards, était consacrée au portrait, mettant en confrontation des tirages d’une douzaine de photographes locaux et studios avec des pièces fantastiques de la collection de Denis Gérard. Nous avons réitéré notre collaboration avec ce dernier à de nombreuses reprises, notamment en mettant sur pied une grande rétrospective sur le chemin de fer franco-éthiopien, puis en publiant sous la direction de l’architecte Fasil Giorgis un livre sur le patrimoine architectural d’Addis-Abeba, des années 1880 aux années 1941. Je me suis vu confier la tâche d’assurer la mise en pages des quelque 500 documents et du texte bilingue qui composaient ce livre. Il s’agit d’un très bel ouvrage que nous revisitons actuellement en vue de produire une seconde édition augmentée, revue et corrigée. Mon poste à l’Alliance fut une époque très enrichissante qui m’a offert l’opportunité de poursuivre un travail très personnel de conception, de commissariat et de montage d’expositions. Cela fait maintenant treize ans que je vis en Éthiopie. Quand je regarde en arrière, je constate qu’il y a eu d’importants changements structurels, politiques, économiques, technologiques et culturels qui se sont répercutés sur toutes les couches de la société, y compris les artistes. De ce point de vue, je soulignerais le développement d’une certaine forme de professionnalisation du milieu de l’art que j’ai pu observer. Ainsi, de plus en plus de galeries et d’espaces d’exposition existent aujourd’hui à Addis-Abeba, même si leur nombre reste encore très limité. Je remarque aussi que beaucoup d’artistes voyagent et que le retour de la diaspora ajoute une certaine valeur aux échanges entre les artistes. Je trouve toujours difficile de m’exprimer au sujet des transformations au niveau global, je préfère parler des évolutions individuelles : il existe des artistes qui vont dans des directions qui, personnellement, m’intéressent énormément et avec lesquels j’ai envie de travailler
Voilà ce que je pourrais dire pour répondre à la deuxième partie de votre question. Bien sûr, il est toujours possible d’apporter des améliorations et il faut continuer à travailler pour accompagner les artistes et sensibiliser le public aux enjeux de l’art contemporain afin d’encourager les politiques d’acquisition des collections privées ou publiques et de poursuivre la recherche. Personnellement, c’est cet aspect qui m’intéresse et me fascine !
D’après vous, quelle place occupe aujourd’hui la photographie dans les pratiques contemporaines des artistes éthiopiens ?
Je ne suis vraiment pas un spécialiste du médium, même si j’éprouve un intérêt particulier pour ce support parce qu’il me rappelle un peu mes origines. En effet, mon père pratiquait la photographie, les toilettes de la maison servaient aussi de chambre noire ! J’entretiens une fascination toute particulière pour cette image qui se révèle comme par magie sur une feuille blanche
À titre personnel, la photographie m’accompagne, au niveau documentaire, quand je voyage. Lorsque je me suis retrouvé catapulté sur le haut plateau abyssin, la photographie s’est inscrite comme une possibilité de raconter un nouveau paysage. De l’appréhender, aussi. Le regard photographique précise et affine le modèle, dans la manière qu’il a de soustraire un fragment du tout. Par la suite, en 1999, en travaillant sur l’exposition sur le portrait, je me suis rapidement rendu compte que l’Éthiopie recelait de ressources extraordinaires en termes de photographie, qu’il s’agisse des photographies « impériales » des studios Boyadjian (présentées il y a quelques années au Jeu de Paume – Hôtel de Sully à Paris) ou bien des portraits miniatures que l’on retrouve dans les cimetières (notons, au passage, que le photographe Michael Tsegaye travaille sur cette thématique aujourd’hui). Dans le cadre de cette exposition, nous avions présenté le travail d’un photographe qui réalise des images qui sont protégées dans des blocs de résine et retouchées à la main avec des teintes de papiers crépon délavés.
J’ai ensuite fait la rencontre d’Antonio Fiorente, avec qui j’ai noué une grande amitié. Nous travaillons très régulièrement ensemble. Je me souviens avoir encouragé le directeur de l’Alliance française de l’époque à engager des photographes pour leur passer des commandes. En l’occurrence, Antonio fut l’un des premiers artistes à qui nous avions demandé de documenter le chemin de fer entre la ville de Dire-Dawa et Djibouti. Après avoir rencontré un franc succès à Addis, l’exposition a ensuite été présentée à Dire-Dawa, sur sa terre d’origine en quelque sorte. Cela a été extraordinaire !
Finalement, la photographie a toujours été présente dans mon travail. Mais en tant que montreur d’images, toutefois, je trouve qu’il y a un décalage entre la profusion de photographies extraites de ce pays et leur présence physique réelle. Ce décalage s’accentue encore aujourd’hui, dans la mesure où il devient beaucoup plus facile de produire de l’image, en particulier dans un pays comme l’Éthiopie où les ressources à potentiel « exotique » sont extrêmement nombreuses. Beaucoup de gens, de voyageurs munis d’appareils, beaucoup de grands photographes sont venus là « se servir », puiser, faire leur « petite chasse à la belle image », peu importe le point de vue, fût-il ethnographique, journalistique ou paysager. Pourtant, on a très rarement eu l’occasion de voir leurs uvres, ce que je trouve personnellement très dommage. Je veux dire par là qu’il y a toujours eu de nombreux photographes en Éthiopie mais que la représentation de la photographie restait très limitée : elle circulait sur des sites Internet mais l’on perdait sa présence physique in situ. Pour ma part, j’ai besoin de la rencontre physique avec l’uvre, j’ai besoin de la manipuler, d’en voir l’épaisseur. Je me nourris de cette confrontation entre le public et une pièce que l’on accroche sur un mur. Dans un très beau texte, comme lui seul peut en écrire, Mulugeta Tafesse, peintre d’exception basé à Anvers, comparait la peinture à un caramel qui fond et se révèle en bouche avec le temps. Je considère qu’il y a de cela dans tous les types d’images et la photographie n’y échappe pas : je vis entouré d’images, de photographies, de dessins que je redécouvre, que je ré-accroche
Je pense que la photographie a cette beauté-là. Et, dans le même temps, peut-être perd-elle en densité tout simplement parce que, de nos jours, on en voit tellement
Ceci est une appréciation extrêmement personnelle, cela n’a évidemment aucun lien avec une quelconque « spécificité » des artistes éthiopiens ni avec la place qu’occupe la photographie dans ce pays.
Une nouvelle galerie, Atelier, que vous dirigez, a ouvert ses portes en décembre 2010 dans la capitale éthiopienne. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots les deux expositions d’ouverture : Impetus et Addis/Chromes de Dawit L. Petros ?
Le travail de Dawit L. Petros, invité l’année dernière en résidence dans le cadre de la première édition de l’Addis Foto Fest, était une confrontation intéressante parce que sa production d’images photographiques (numériques) s’ancre dans une démarche plus vaste qui englobe la peinture, l’architecture et l’urbanisme ; une pratique d’installation et un questionnement pertinent et subtil, à mon goût, de la notion de frontière. Parallèlement à cela, l’exposition Impetus(1) (car l' »impétuosité » est l’un de mes traits de caractère et la pratique d’Atelier en est le fruit) présentait des uvres sur papier, sur toile, des sculptures et permettait d’inscrire la scène contemporaine en contrepoint, hors du champ de la photographie qui était artificiellement placée sous les feux des projecteurs le temps d’un Fest. Je trouvais intéressant de présenter ce qui, en Éthiopie, est peut-être la formation ou le type d’uvre qui circule davantage : la photographie y demeure comme une sorte de footnote, à la fois en termes de marché et de pratique, et ce, en dépit du fait que les images qui sont davantage diffusées hors de ce pays sont de nature photographique.
Cela fait un an que l’aventure d’Atelier a commencé mais, en ce qui me concerne, cela fait treize ans que j’explore ce vaste territoire. Cette galerie s’inscrit dans la continuité de ce que j’avais entrepris au départ à l’Alliance française puis poursuivi avec le Taitu International Art Center qui a fonctionné pendant dix mois en l’an 2000. Cette structure offrait une alternative aussi bien autant en termes d’espace que de programmation, en particulier grâce à sa dimension pluridisciplinaire : nous y invitions des artistes en résidence, des danseurs, des gens de théâtre ou encore des écrivains. Pierre Michon, notamment, y fit une présentation mémorable de ses écrits sur Rimbaud. Tout cela se déroulait dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Taïtu. Nous avions également coproduit des pièces de théâtre en amharique, telles que l’Oncle Vania dirigée par Geneviève Rosset avec Asnaqetch Worku, Tesfaye Gessesse, Haimanot Alemu à l’affiche
Ce fut un moment extraordinaire, à l’instar du concert Jump to Addis qui trouva ensuite sa place dans la magnifique série des Éthiopiques produite par le maestro Francis Falceto. Malheureusement, ce lieu a été fermé en 24 heures, d’une manière que l’on pourrait qualifier de précipitée et autoritaire, sans que l’on ne m’en explique vraiment les raisons. Pendant les quatre années qui ont suivi, j’ai enseigné l’histoire de l’art et l’esthétique à l’École des Beaux-arts. Ce poste d’enseignant m’a permis de me replonger dans l’histoire de l’art et d’accompagner de jeunes étudiants avec lesquels, certains étant depuis devenus artistes, j’entretiens une relation toute particulière.
En 2007, après près d’un an de travaux, j’ai ré-ouvert, en partenariat avec Lilly Sahle, un espace d’exposition dans une ancienne usine de pneus de 2000 m2 : la galerie Lela. L’espace était vraiment splendide et offrait des volumes particulièrement intéressants à travailler. Nous y avons organisé treize expositions magnifiques. Il y avait non seulement une continuité avec les artistes, une véritable dynamique mais aussi l’esprit du lieu qui compte beaucoup pour moi. La galerie formait une plateforme pluridisciplinaire et donnait lieu à des rencontres de différents genres. Pareillement, comme un mauvais sort, ce lieu s’est retrouvé « saisi » par les autorités en l’espace de 48 heures et a depuis été transformé en centre de détention. L’aventure aura duré deux ans, de 2006 à 2008. Je me suis ainsi retrouvé une fois de plus sans lieu, à monter des expos ici et là. Le projet H*tel Dystopia m’est soudainement venu à l’esprit de façon quasi épidermique, d’une part en réaction à la fermeture successive de tous ces espaces dans lesquels je m’étais investi et, d’autre part, en réponse à d’autres lieux qui s’ouvraient alors à l’art et qui, personnellement, m’inspiraient une certaine forme de distance critique. J’entends par là le projet d’expositions de l’hôtel Sheraton, Art of Ethiopia, qui en est aujourd’hui à sa quatrième édition. Il s’agit d’une alternative, certes très intéressante, mais quand j’ai vu le Sheraton Addis Five Stars Hotel – entité sans nom et aux critères très particuliers – réclamer le titre tant envié et un peu passe-partout de commissaire d’exposition, j’ai trouvé cela véritablement fabuleux !
Si j’évoque le projet H*tel Dystopia, c’est parce qu’il est en quelque sorte à l’origine d’Atelier et parce qu’il a inscrit ma pratique de commissaire indépendant dans un espace qui n’est justement pas tributaire d’un lieu spécifique mais plutôt d’un espace mental qui peut être virtuel, à l’instar du site Internet qui s’en fait l’écho, et finalement, de tous ces projets d’expositions qui ne verront jamais le jour.
Aujourd’hui, je me retrouve une fois encore confronté à la question du lieu : Atelier a clos sa saison en mai dernier et là, je me pose des questions quant à savoir si l’on va pouvoir ouvrir à nouveau, comment il sera possible de travailler dans les mêmes conditions, car entre-temps, de nombreux bouleversements sont venus changer la donne
Au sujet de la programmation d’Atelier : les deux premières expositions Impetus et Addis/Chromes ont été très bien accueillies et nous ont permis de réapparaître tambour battant sous les feux de la rampe. Nous avons ensuite enchaîné avec une rétrospective consacrée au travail de Daniel Tayé, un peintre avec lequel j’ai toujours travaillé et pour lequel j’ai produit une pièce de théâtre qu’il avait écrite il y a dix ans et dans laquelle il mettait en scène sa propre mort (Égélé, présentée au Taitu International Art Center). Daniel Tayé construit et déconstruit un univers comme cela, d’une radicalité picturale et d’une densité toute « romantique » extrêmement intéressantes. Au moment où nous avons commencé à réfléchir aux possibilités de dévoiler son travail, nous avons décidé de faire un état des lieux de son atelier et de sortir toutes les pièces qu’il avait réalisées depuis une quinzaine d’années. Au final, nous avons présenté une soixantaine d’uvres qui dataient du milieu des années quatre-vingt-dix à nos jours. L’exposition a créé une certaine confusion aux yeux du public, à qui finalement elle n’était pas destinée. Mais c’est aussi comme ça que je conçois le rôle d’Atelier. Nous lui avons également confié un espace dans lequel il a pu travailler dans une dynamique d’installation et de performance. Voilà une autre facette de Daniel Tayé : un performer qui vit son uvre de l’intérieur. Pour mettre à profit la versatilité du lieu et aménager au mieux le volume disponible – Atelier s’étend sur 600 m2 ! – nous avons fait appel à l’architecte londonien Tim Todd : il a créé ainsi une partition qui autorise une meilleure navigation et la mise en place de davantage de cimaises. Dans le cadre de cette exposition, le plus grand espace était consacré à Daniel Tayé. En parallèle, j’ai monté Neoscape, une exposition de groupe pour laquelle nous avions invité huit artistes à réfléchir sur les sujets et les motifs qui hantent la peinture de Daniel, à savoir le rapport à la figure, au modèle, au paysage, à la mort, la permanence de la silhouette, de l’ombre ou la question de l’image dans l’image
Ces récurrences identifiées dans le travail de Daniel ont donné lieu à des combinaisons vraiment intéressantes, et ce à travers des pièces aux qualités esthétiques très diverses. Ce fut notamment le cas du travail de Klaus Mertens, sculpteur allemand formé par Baselitz qui présentait des gravures sur bois, ou du travail photographique en noir et blanc de Michael Tsegaye qui portait un regard sur l’altération du schéma urbain d’Addis-Abeba. Dans son cas, il s’agissait de trois pièces, constituées de collages et d’assemblages, d’images dans l’image. À leurs côtés, Tewodros Hagos – très connu aujourd’hui grâce à sa marque de fabrique qui se caractérise par des portraits grands formats d’une rare puissance – présentait de petits fragments de paysages, résultant d’impressions numériques de promenades effectuées avec d’autres peintres : la photographie documentait, l’huile sur toile recadrait et fixait de manière pérenne ces instants volés sur les chemins de la campagne alentour. Antonio Fiorente, quant à lui, posait un regard de toute beauté sur un modèle et cette femme devenait paysage, son corps un territoire vaste et poétique. Nous présentions aussi l’uvre de deux femmes artistes qui, pour moi, sont des artistes clés de la scène locale : Bisrat Shibabaw, dont le travail flirte constamment avec une sorte de fragile poésie, mettant en scène dans ses tableaux des femmes ou des couples qui sont représentés dans leurs lits. Et puis, à chaque fois, un animal se retrouve plongé dans l’environnement du sommeil de ces amoureux ou de cette rêveuse : on ne sait même pas trop si c’est un rat ou si c’est un chien
Dans son travail, elle s’interroge sur cette cohabitation, à savoir le rapport qui existe entre l’animal et l’être humain et, en filigrane, la part animale de l’humain. À cette occasion, nous avons également donné l’une des premières vues du travail d’une autre jeune artiste que j’aime beaucoup, Hana Yilma. Une jeune peintre déterminée, talentueuse et fraîchement diplômée de l’École des Beaux-arts d’Addis. Elle réalise un travail sur la femme et sur l’intimité du bain, du spa, du sauna ou de tous ces endroits où, tout d’un coup, on est nu face à soi-même. Ces personnages se reflètent dans de vaporeux miroirs, se dédoublent et se retrouvent face à leur propre corps. Hana Yilma pose un regard intime sur l’anatomie : ses corps sont pesants, en suspens, plongés dans des univers doucement opaques. Raffinement de la mise en image de l’image, poésie de ce rapport au corps sous les pinceaux d’une femme, à l’opposé de la charge érotique du rapport que Daniel Tayé, tel un Schiele, entretient avec ses modèles. Dans la continuité, on présentait de Mulugeta Tafesse des petits formats sur papier : des scènes urbaines de la ville d’Anvers et une pièce fabuleuse sur les murs de Harar. Cela s’inscrivait aussi en contrepoint du travail de Carlos Mariné, un artiste espagnol dont les encres étaient également exposées dans Neoscape et qui rendent compte de sa vie à Harar. Nous proposions ainsi une sorte de navigation aux frontières très poreuses et dont la cartographie n’existait que de manière sous-jacente. Il était important pour moi de faire cohabiter toutes ces productions si différentes et de provoquer de vrais débats et discussions, ce que cette exposition n’a pas manqué de susciter ! En effet, nous présentions également à cette occasion, en off dans le cadre de soirées, l’uvre d’Ezra Wubë, un jeune artiste éthiopien basé aux États-Unis, à travers une rétrospective consacrée à son travail de vidéaste – baptisée Memory and Process – qui se composait d’une sélection de sept courts-métrages. Ce qui est très intéressant dans ses productions, c’est qu’il s’investit, au départ, dans une pratique de peinture et, lorsqu’il se retrouve sans atelier pour travailler, il se dirige alors, par nécessité, vers la pratique de la photographie et de la vidéo. Ainsi, à la manière de William Kentridge, il a revisité sa peinture en travaillant son dessin. L’espace de la galerie s’est ainsi mué en espace de projections, chacune accompagnée de la présentation de l’artiste. Le public venait voir des films qui n’étaient pas du cinéma. Cette démarche inscrivait d’emblée la galerie dans une dynamique différente, et c’est un esprit qui me plaît.
L’exposition suivante était intitulée An Obscure Taxonomy (of noble lines). Il est évident que, pour moi, tout le discours de l’uvre, autour de l’uvre et de la conception d’expositions, est très important. Établir une taxonomie un peu étrange, en mode shuffle, mélanger les uvres d’artistes extrêmement divers, les pratiques du dessin et de la peinture, tout cela par rapport à la ligne : tel était l’enjeu de cette exposition ! Cela m’intéressait personnellement, non seulement d’un point de vue formel mais aussi par rapport à la frontière un peu poreuse qui existe entre les différentes pratiques et entre les pratiques artistiques et sociales. Cette exposition a suscité beaucoup de questions, elle a fait beaucoup rire aussi. Nous nous sommes même retrouvés dans une situation un peu délicate parce que l’interprétation malveillante vous conduit parfois sur des sentiers qui sont à la limite de la légalité. Franchir la ligne « rose », c’est s’exposer
alors évidemment le travail d’Eve Ensler peut déclencher la polémique. Par ailleurs, j’avais sollicité pour cette exposition, à travers une correspondance en ligne, la participation d’Ermias Kifleyesus, un autre excellent artiste éthiopien basé en Belgique et dont le travail m’intéresse énormément. Ne pouvant être présent ni pour le montage ni pour le vernissage, il m’a donc donné des instructions pour l’accrochage que je devais mettre en uvre à sa place. J’ai donc fait acheter des posters dans la rue représentant ces nouveaux héros ou héroïnes aux poses lascives, « iconolâtres » bodybuildés, kitsch à ravir, entrés dans le domaine de la grande consommation publique
Toutes les discussions avec Ermias se sont déroulées via Internet et par téléphone : l’idée était de mettre en place une surface participative (une sorte de « mur Facebook », sans écran) sur laquelle le public était invité à écrire, commenter, dessiner, intervenir directement avec des marqueurs sur ces posters, le tout sur un mur de huit mètres de long et de trois mètres de haut. Chacun réagissait à la fois au type d’images qui étaient présentées et aux commentaires qui avaient précédemment été inscrits par d’autres. Une sorte de dialogue et de jeu s’est donc instaurée entre l’artiste, le public, mon assistante et moi-même qui intervenions en vue de nous assurer que tout se passait dans le respect des règles et des contraintes qu’Ermias avait décidé d’imposer. Dans cette exposition, nous présentions également une pièce de Benjamin Sabatier, jeune artiste français qui travaille avec la galerie Jérôme de Noirmont. Il met des uvres en ligne « à la façon Ikea », c’est-à-dire avec leurs modes d’emploi : il offre ainsi à tout un chacun l’occasion de s’approprier le monde, en démocratisant ses uvres. Nous avions décidé de présenter sa carte du monde en la construisant dans la galerie simplement à l’aide de clous et de marteaux : cinq kilos de clous enfoncés dans grand un mur blanc, une pièce intéressante qui se créait par le vide
Il y avait aussi Eyob Kitaba, un jeune artiste avec lequel je travaille beaucoup. À l’occasion de sa toute première exposition, nous avions choisi de présenter cinq uvres de format imposant réalisées sur papier d’architecte – les grands papiers bleus sur lesquels on imprime les plans ou blueprints et, à l’extrême opposé, une série de Post-it® (que j’avais déjà exposée à la Bastakiya Art Fair à Dubai l’année précédente), de tout petits dessins
à la Jean Zuber.
L’Atelier permet donc une navigation permanente entre les uvres, les échos qui résonnent entre elles, les artistes
Il est difficile de résumer tout ce qu’il s’y est passé depuis son ouverture !
Comment la galerie fonctionne-t-elle ? Est-ce qu’elle défend le travail de quelques artistes en particulier ? Sur le site Internet de la galerie, l’on peut lire : « Atelier met en uvre une stratégie novatrice en faveur du développement artistique qui repose sur des solutions commerciales éprouvées et des services innovants ». Quelles sont ces stratégies, plus précisément ?
Comment fonctionne la galerie ? C’est quelque chose que je ne sais pas moi-même ! Les artistes avec lesquels je travaille ne sont pas sous contrat, il n’y a pas de contrat d’exclusivité
Ici, on est tout sauf une écurie de Formule 1 ! L’Atelier a vu le jour à un moment où d’autres lieux s’ouvraient à Addis-Abeba. L’ouverture de la galerie, de mon point de vue, s’apparente à un acte citoyen, dans le sens où elle participe à la vie de la cité ainsi qu’à la vie du milieu artistique dans lequel les artistes et moi-même sommes impliqués. Il me paraît très important de rappeler ce point. D’autre part, la galerie défend forcément le travail de certains artistes tandis qu’il y en a beaucoup d’autres avec lesquels je n’ai plus du tout envie de travailler.
Il y a un côté « dictatorial » dans l’exercice des fonctions de commissaire et de galeriste. En d’autres termes, il faut suivre son instinct, se laisser guider par ce que l’on aime
L’Atelier est un espace de travail à la fois pour les artistes mais aussi pour moi en tant que praticien, il s’agit d’une pratique « installatoire » assumée, des uvres. Je travaille avec des artistes avec qui je peux véritablement discuter et avec lesquels je peux m’engager sur un territoire où la prise de risque est partagée et, dès lors, où le plaisir l’est aussi ! Je me plais à penser que cette relation est similaire à celle qu’instaure un chorégraphe avec ses danseurs, parce qu’on travaille sur des projets qui sont communs, pas communs dans la manière dont on les conçoit, mais dans l’espèce d’ultime objectif que l’on se fixe : poursuivre cette recherche permanente d’exploration du champ des possibilités de l’image
En ce qui concerne la deuxième question, notre devise est Save money, buy art, ce qui signifie, grosso modo : « Faites des économies, achetez des uvres d’art » ! Je suis moi-même collectionneur, et si je peux parler avec enthousiasme des artistes dont j’expose le travail, c’est parce que, pour la plupart, ils pourraient intégrer ma propre collection si j’en avais les moyens financiers
D’un côté, il y a des uvres que j’aurais voulu acquérir mais qui sont parties dans des collections privées (et je me réjouis qu’elles le soient parce que je sais qu’elles sont entre de bonnes mains et sous de bons yeux) et d’un autre côté, il y a aussi des pièces que j’aurais préféré ne pas vendre plutôt que de les céder à ceux à qui j’ai dû les vendre
Ce sentiment accompagne, j’imagine, tous les galeristes et toutes les pratiques de marchand d’art. Quant aux « solutions commerciales éprouvées et [aux]services innovants », celles-ci consistent à mettre en avant la dynamique que j’ai évoquée précédemment – treize années de pratique – et aussi le fait que la vente en tant que telle n’a jamais été une priorité. Ainsi, quand j’accroche des uvres, je ne me dis pas en me frottant les mains : « Eh, eh, celles-ci, je vais pouvoir les vendre
». Ce qui est important à mes yeux, c’est le travail accompli : la conception et le montage des expositions, les titres, les textes et la manière dont tous ces éléments s’articulent.
Quand on fait référence aux solutions commerciales éprouvées, cela signifie que l’on sait de quoi on parle et que les pièces que l’on expose valent la peine d’être observées, au-delà de leur valeur commerciale, laquelle est d’ailleurs compliquée à définir dans le marché émergent de l’art qui caractérise le contexte local. Quelles que soient les circonstances, les uvres ont une valeur sentimentale qui m’importe davantage que leur valeur purement financière.
Ceci dit, en ce qui concerne les « stratégies », nous essayons d’inviter un maximum d’artistes et de mettre en place des rencontres de tous les types. Le support que représente notre site Internet est également très important pour nous, tout comme, dans la continuité du projet H*tel Dystopia, cette dynamique qui permet d’accrocher des uvres dans les endroits les plus improbables et, surtout, de sensibiliser de potentiels nouveaux collectionneurs. Il est vrai que l’achat d’une première uvre est un pas à franchir, aussi bien pour une personne extrêmement aisée que pour une personne qui l’est beaucoup moins mais qui a le sentiment qu’avoir une uvre chez soi participe à un « meilleur-être »
Il s’agit ainsi et surtout de susciter l’envie, d’éveiller le désir.
Pendant la saison 2010-2011, la galerie mettait en uvre également des actions pédagogiques en direction des scolaires de la capitale. Comment ces activités s’articulent-elles exactement avec la vie de la galerie et celle des établissements scolaires ? Et quels sont les objectifs à moyen et à long terme pour ce volet ?
C’est ce que j’ai toujours fait et je reviens à l’aspect médiation qui, pour moi, revêt une importance capitale. L’uvre existe dans l’atelier sous le regard et dans l’esprit du producteur, l’artiste. Mais, en même temps, elle prend une nouvelle dimension quand, tout à coup, elle est vue. La rencontre avec le public, quel qu’il soit, est fondamentale ! La pédagogie ne s’adresse pas seulement aux 3-18 ans, pas nécessairement à un public d’enfants, en milieu scolaire, même si cela compte et même si nous avons déjà organisé ce genre de rencontre. Je considère que l’aspect pédagogique existe aussi dans la confrontation avec le public en général, bien au-delà des bacheliers !
Au sujet du public scolaire, il se trouve que j’enseigne depuis 4 ans les arts visuels à l’International Community School d’Addis-Abeba. Je travaille avec une quarantaine d’élèves, en particulier dans le cadre du diplôme du Baccalauréat international. Ce programme extrêmement bien conçu s’articule en substance sur deux années durant lesquelles un petit groupe d’élèves choisit à la fois leur discipline et l’objet d’étude qu’ils souhaitent approfondir à travers une partie consacrée à la recherche sur le plan esthétique, théorique et historique et une partie consacrée au travail d’atelier qui vient véritablement compléter la première. Ce cadre de travail m’a donné l’occasion de m’interroger sur la manière dont on appréhende, dont on « dissèque » l’uvre, ainsi que sur la manière de la rendre « digeste » pour des publics de différents niveaux. Il y a donc l’enjeu d’inscrire l’uvre dans une pratique de société. Avec les élèves de cette école, nous avons créé un site Internet sur lequel nous documentons tous les travaux réalisés autour des uvres, de même que les travaux des artistes eux-mêmes, ainsi qu’une plate-forme 2.0 ayant pour objectif à la fois de créer une sensibilité artistique et d’inviter les gens à découvrir des uvres et à se poser des questions à partir de celles-ci. J’en reviens ainsi à l’idée de la validité de la production d’images au XXIe siècle, dans un environnement où l’on est déjà hyper-saturé d’images en raison d’Internet, de la télévision, des publicités urbaines
Dès lors, comment apprendre à les lire ? Voilà une question qui me passionne.
En consultant le site Internet de la galerie, je découvre une édition « collector » du travail du photographe Michael Tsegaye, « Currents I, II & III ». Comment avez-vous travaillé à ce projet éditorial ? La galerie va-t-elle poursuivre un travail dans ce sens, régulièrement, et avec d’autres artistes ?
C’est amusant que vous en parliez comme d’un projet éditorial ! Nous avions été confrontés à des difficultés d’ordre financier lors de la production d’une uvre de Michael dans le cadre de l’exposition Neoscape. J’ai alors soumis l’idée de réaliser une série « collector » car certaines personnes nous avaient fait savoir qu’elles auraient été éventuellement intéressées par son acquisition. Nous l’avons donc annoncée, sachant que nous nous étions fixé une limite de sept tirages par pièce
Néanmoins, personne n’a finalement souhaité passer à l’action, cette initiative en est donc restée au stade du « projet éditorial ». Pour revenir à la question de l’impact de la photographie sur les pratiques des artistes éthiopiens contemporains, j’observe que la photographie reste un medium qui est un peu regardé de biais par le collectionneur. L’uvre photographique – et j’irais même jusqu’à dire, de manière générale, l’uvre sur papier – ne reçoit pas ici le même égard que la peinture. La peinture sur une vraie toile est considérée comme une uvre d’art unique. Quant à l’estampe, au dessin
il ne s’agit « que » de papier ! On observe donc une sorte de scepticisme de la part des collectionneurs. Pour ma part, je suis un mordu des uvres sur papier. Ce sont des pièces que je collectionne vraiment avec envie et, de mon point de vue, une bonne gravure vaut bien mieux qu’une mauvaise peinture ! Quant à la vente de la photographie, mon expérience de marchand me permet d’affirmer que celle-ci demeure une activité très épisodique et extrêmement limitée. Cette situation soulève des questions à la fois pour le photographe, pour les artistes et pour le collectionneur : savoir comment et combien de tirages sont réalisés, s’ils sont numérotés, etc. Ces aspects ne sont pas toujours évidents à déterminer. Ainsi, je vois des photographes qui impriment leurs photographies sous forme de cartes postales et les vendent un euro pièce sur les marchés. Il va sans dire qu’une telle pratique n’incite pas le même artiste à vendre ses photographies 150, 250 voire 300 euros en galerie. Il serait intéressant d’aborder ce sujet avec les photographes, mais, finalement, j’en connais peu qui vivent de leur travail, je pense notamment à Antonio Fiorente et à Michael Tsegaye. Dans le cas d’Antonio, cela s’explique aussi par le fait que sa pratique relève de celle du documentariste, du reporter : il convient donc de tenir compte de tout l’aspect social et commercial de cette pratique. Michael se situe sans doute plus sur le segment de l' »art contemporain » ou de la « photographie africaine » (très en vogue
). Sa formation à l’École des Beaux-arts et ses ambitions artistiques le différencient à cet égard d’Antonio.
Quels sont les projets artistiques à venir à l’Atelier ?
Ils sont contraints par les circonstances. À l’heure actuelle, j’ignore de quoi sera fait l’avenir d’Atelier du point de vue de l’espace car le lieu est actuellement soumis à des spéculations immobilières qui m’interdisent toute certitude quant à la possibilité d’assurer la programmation de la deuxième saison. Néanmoins, je prends maintenant cela avec beaucoup de détachement, ayant appris en Éthiopie à anticiper l’inattendu ! Enfin, peut-être est-ce la vie qui veut cela : avant que je m’expatrie, mon père me disait que ce n’est pas le chemin qui est difficile mais le difficile qui est le chemin. Je pense que j’ai tiré de nombreux enseignements de mes expériences dans le milieu de l’art, à Addis-Abeba en particulier, en évoluant au sein d’environnements dans lesquels les choses peuvent changer ou prendre une orientation complètement différente du jour au lendemain. Ainsi, peut-être continuerons-nous l’aventure, changerons-nous de nom, de lieu, et qui sait, peut-être le projet H*tel Dystopia pourra-t-il prendre d’autres dimensions. Finalement, j’ai toujours été détaché de toutes ces contraintes liées à l’obligation de réussir. M’inscrire dans la durée, ce n’est peut-être pas quelque chose qui me convient à titre personnel. Si une telle philosophie peut surprendre, on peut aussi l’interpréter comme étant l’essence de la versatilité, le désir d’être entre deux temps, deux lieux, entre plusieurs séquences
In fine, « qui sont » les collectionneurs qui acquièrent des uvres d’art auprès de votre galerie ?
Il serait réducteur de ne parler que du travail d’Atelier parce que, comme je l’ai dit, cela fait dix ans que je travaille dans ce milieu. Le collectionneur typique n’existe pas ! Néanmoins, il est évident que, dans la plupart des cas, le collectionneur a de l’argent. Il est affranchi des petites problématiques existentielles telles que payer son loyer, sa nourriture et ses transports. Il n’y a là rien de typique par rapport au marché de l’art en Éthiopie, je présume. Ce qui est intéressant ici, c’est d’observer les limites qui se posent en termes de budget, c’est-à-dire qu’au-delà d’un certain seuil, le collectionneur « type » étranger va être beaucoup plus réticent à dépenser. Je ne saurais vous dire précisément à combien s’élève ce plafond. Disons qu’il ne dépensera guère plus de 1 000, 1 500 euros. Pourtant, peuvent se trouver dans ce cas de figure des diplomates pour lesquels des sommes telles que 1 000, 2 000, 3 000 et même 5 000 euros restent une « broutille » dans leur chiffre d’affaires mensuel. La plupart n’a pas conscience de cette possibilité d’envisager l’acquisition d’uvres d’art comme un investissement à long terme, elle relève alors plutôt du domaine du souvenir. Ils souhaitent plus simplement marquer une étape. Ainsi, après avoir été en poste en Éthiopie pendant trois ou quatre ans, ils vont donc ramener « quelque chose » du pays. À ce propos, il convient par ailleurs de noter qu’il existe quelques artistes « stars » qui ont réussi à infiltrer ce marché et qui sont devenus le sujet de toutes les conversations dans les dîners en ville.
Je connais aussi des diplomates qui s’inscrivent dans une démarche un peu plus sérieuse. Par leurs acquisitions et le suivi qu’ils en font, ils se veulent reconnaissants et respectueux à la fois du travail de l’artiste et de notre propre travail d’accompagnement pour la circulation des pièces uniques. Viennent ensuite les collectionneurs éthiopiens qui, faute d’être nombreux, sont extrêmement sérieux. Ces derniers possèdent des collections privées, historiques, développées depuis quarante, cinquante, voire soixante ans par leurs parents et qui savent pertinemment que des pièces achetées il y a quarante ans valaient à l’époque quarante fois moins que ce qu’elles ne valent aujourd’hui. On peut discuter en toute franchise de ce que représente l’uvre que je présente et, connaissant leurs collections, les conseiller sur le choix d’une pièce qui constituera une pierre angulaire dans leur collection.
Le collectionneur étranger représente environ 60 à 70 % des ventes mais il dispose d’une une limite budgétaire. Enfin, 30 à 40 % des ventes vont se conclure à l’échelle locale auprès de collectionneurs beaucoup plus inventifs. Ces derniers partent du principe que la constitution d’une collection ne se fait pas sur trois ans mais plutôt sur quinze ou vingt ans et considèrent que le fait d’accompagner les artistes dans la durée leur permet d’acquérir des pièces qui sont essentielles dans le cheminement d’un peintre qui aura vingt ou trente ans de carrière.
Il convient de préciser que cela reste un marché de première main : il n’y a pas d’antiquaires. Peut-être existe-t-il une ou deux personnes qui entreprennent des tentatives en ce sens, mais celles-ci demeurent très faibles. Quant aux artistes décédés, les plus chanceux rentreront au musée ou passeront à la postérité, à l’instar de Gebre Kristos Desta. Les autres tomberont dans l’oubli pendant plusieurs années ou pour toujours, comme c’est le cas, à mon très grand regret, de Yohannes Gedamu, à qui je dois beaucoup et dont la petite voix accompagne beaucoup de mes actions.
Voilà les réponses, incomplètes sans doute, que je peux vous apporter et les pistes qui restent à explorer. Voilà aussi pour le portrait, sans doute très approximatif par rapport à une situation locale et à un parcours qui n’est surtout pas figé mais, bien au contraire, toujours en mouvement. Passionnant travail que celui de mangeur de clous ! Car – et il s’agit là d’un clin d’il à Maurice Denis – il me plaît de rappeler « qu’une exposition, avant d’être plus ou moins anecdotique, est essentiellement une surface recouverte de pièces dans un certain ordre assemblées, grâce à l’usage d’un niveau à bulle, d’un mètre, d’un escabeau, d’un marteau et d’une poignée de clous
».
1. À noter qu’Impetus a été la première exposition à prendre un nom latin. La première saison de la galerie s’est close sur In cauda…///Article N° : 10591