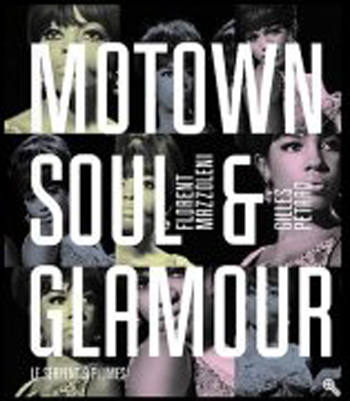Journaliste, auteur, photographe et avant tout grand mélomane, Florent Mazzoleni est passionné de musique africaine à laquelle il consacre une grande partie de son temps, à travers la rédaction d’ouvrages, la réalisation de compilations et des conférences données en Afrique mais aussi en France et notamment à Bordeaux où il vit. Auteur de L’Épopée de la musique africaine en 2008 (1), il a publié à la fin de l’année 2009 un beau livre sur le Motown, le premier label noir à avoir bouleversé l’industrie musicale américaine (2) et une biographie de Salif Keita (3). Rencontre.
Comment la musique africaine dans laquelle vous êtes aujourd’hui totalement investi est-elle entrée dans votre vie ?
Tout simplement en allant au Mali en 2005 pour un voyage de presse à l’occasion de la sortie d’un disque d’Ali Farka Touré. Cette rencontre déterminante a été pour moi une révélation.
J’ai alors voulu comprendre ses musiques, pourquoi quelqu’un comme lui avait une telle aura et quel était le pays qui lui avait donné les moyens de s’exprimer artistiquement.
À Bamako, j’ai ressenti une sympathie extraordinaire pour la ville. J’ai eu l’impression d’être chez moi. J’ai souvent voyagé et j’ai déjà eu ce sentiment dans d’autres villes mais pas de manière aussi intense.
C’est de cette rencontre avec le Mali et Ali Farka Touré qu’est né votre projet d’écrire L’Épopée de la musique africaine ?
À partir de cette rencontre, je me suis intéressé aux musiques africaines. En tant que lecteur je ne trouvais pas d’ouvrage en rapport avec ce qui m’intéressait. C’était quelque chose qui manquait dans l’édition de livres sur la musique africaine, mais parler de la musique africaine c’est un non sens absolu parce qu’il y a bien sûr des musiques africaines. J’ai eu envie de rendre hommage à toute la façade Atlantique. Il m’a fallu trouver un axe, c’est pour cela que le livre est sous-titré Rythmes d’Afrique atlantique, couvrant une zone géographique allant du Sénégal à l’Angola. C’est une synthèse assez modeste mais elle ouvre une voie qui pourrait être enrichie par d’autres publications.
Votre ouvrage qui n’a pas la prétention d’être exhaustif ne couvre en effet pas tous les pays. Certaines zones géographiques sont absentes ainsi que certaines figures comme Pierre Akendengue. Quel est son parti pris éditorial ?
Je ne parle effectivement pas de lui mais j’aimerais bien y revenir dans un autre ouvrage. De même je ne parle pas de l’orchestre FAG-Massako du Gabon et j’évoque très peu Francis Bebey, doyen de la musique africaine et d’ailleurs le premier à lui avoir consacré un livre paru en 69 (4). Ces grands artistes avaient une haute conscience sociale qui était très présente dans leurs textes mais j’étais moins sensible à leur musique et j’ai le sentiment qu’il est convenable d’écrire sur ce que l’on aime, sur des musiques qui suscitent en nous des émotions.
Je pense qu’il y a une communauté de sentiments en dépit des barrières linguistiques et socioculturelles le long de cette Afrique atlantique où je parle également du Mali. C’est un concept qui ne tient peut-être qu’à moi mais qui me parle. Il me semble que les années 70 ont été un laboratoire à ciel ouvert pour les musiciens africains confrontés au funk, au reggae, au hip-hop, au jazz, à des musiques qui étaient essentiellement noires américaines, voire brésiliennes, qui ont eu un impact énorme sur les créations musicales d’Afrique de l’Ouest mais aussi des deux Congo.
Comment se caractérisait musicalement cette Afrique atlantique ?
Par une intensité, une manière de jouer que l’on ne trouvait pas ailleurs. Il y avait surtout une synthèse parfaite entre la tradition – notamment bambara et mandingue – et la modernité venue d’outre atlantique qui a embrasé les orchestres.
La musique africaine moderne utilise bien sûr les instruments traditionnels mais surtout des cuivres. Le terme de jazz était d’ailleurs synonyme de modernité. Pas mal d’orchestres notamment au Congo, comme L’OK Jazz de Franco et le Bembeya Jazz en Guinée utilisaient ce vocable qui renvoyait à une sorte de modernité occidentale et américaine. Ces musiques étaient également liées à la guitare introduite dans les orchestres et dont le Guinéen Sékou Diabaté reste l’un des grands virtuoses. La décennie 70/80 a été extrêmement importante car c’est une époque de fusion et de synthèse entre différents courants musicaux. Elle incarne aussi une prise ouverte de conscience politique mais également un certain recul par rapport à l’euphorie des années 60.
Envisagez-vous de donner une suite à ce travail ?
Je l’espère, notamment sur l’Afrique du Nord, une zone qui me parait fondamentale mais que je ne suis pas qualifié pour couvrir. J’ai déjà un chapitre inédit sur l’Éthiopie et j’aimerais travailler sur les rivages de l’Océan Indien. Il faudrait aussi couvrir l’Afrique australe où l’Afrique du Sud, pays qui mériterait un livre à lui seul de même que les deux Congo qui ont une histoire musicale phénoménale.
Bizarrement, ces choses auraient dû être entreprises il y a une trentaine d’années. Certains l’ont peut-être fait, mails il en reste peu de traces, en tout cas dans les pays francophones car les Anglo-Saxons qui ont publié divers livres sur le sujet, sont bien plus en avancés dans ce domaine (5).
Vous insistez dans cet ouvrage sur les liens entre musique et politique symbolisés par les divas officielles qui chantent au service d’un Mobutu ou d’un Sékou Touré mais aussi par l’exaltation des » identités nationales » dont la chanson de Grand Kalle Indépendance Cha Cha reste emblématique
Je voulais montrer que l’explosion des musiques modernes africaines et en particulier celle des musiques de l’Afrique Atlantique, est liée à la période coloniale et aux indépendances. Des pays comme le Ghana de 1957 ou la Guinée de 1958 ont eu un grand rayonnement sur le continent. L’Afrique Atlantique était tenaillée par la politique d’authenticité culturelle de Sékou Touré qui a fait de la musique à cette époque l’élément le plus visible de sa politique culturelle. L’exaltation nationale devait passer par la musique. Le Congo (Kinshasa) a lancé le premier tube musical du continent avec Indépendance Cha Cha de Grand Kalle & l’African Jazz, qui a été un succès phénoménal du Maroc à l’Afrique du Sud. Sous des airs assez légers et divertissants, inspiré par la musique afro-cubaine, ce morceau a eu une portée d’émancipation et de libération extraordinaire. J’ai été fasciné de voir à quel point la notion d’indépendance et d’affirmation de soi pouvait être véhiculée par le biais d’une chanson.
Je souhaitais montrer en quoi certains régimes comme la Guinée de Sékou Touré, mais aussi le Mali de Modibo Keita et, dans une moindre mesure, le Sénégal de Senghor et le Zaïre de Mobutu, avaient lancé des grandes productions nationales avec des disques publiés par des labels d’État. La plupart des productions d’alors était le fait de radios d’État comme Radio Sénégal, Radio Mali ou le Studio de la révolution en Guinée. Parallèlement à ces orchestres régionaux et nationaux subventionnés par les États, ont émergé des orchestres privés.
Et cette compétition entre orchestres privés et orchestres nationaux ou régionaux a suscité une saine émulation musicale dans différents pays d’Afrique de l’Ouest.
Vous revenez également sur le rôle que jouera plus tard la capitale ivoirienne qui a été une grande plate-forme musicale. Quel a été son impact ?
À la fin des années 70, après la faillite de la seconde république malienne et surtout du régime de Sékou Touré qui commençait à agoniser et qui s’était considérablement durci, pas mal d’artistes d’Afrique de l’Ouest se sont retrouvés à Abidjan, devenue une plate-forme économique grâce à l’essor des productions de café et de cacao. Des petits labels indépendants ont alors émergé, notamment libanais comme Safiedeen, et des studios d’enregistrement sont apparus commençant à anticiper le potentiel commercial de ces musiques au-delà des frontières.
C’est ainsi que la plupart des grandes vedettes des années 80 se sont retrouvées à Abidjan qui a été un véritable tremplin pour beaucoup d’entre elles notamment Salif Keita et Mory Kanté venus avec leur orchestre respectif. Manu Dibango a dirigé un temps l’orchestre de la Radio télévision ivoirienne, le Congolais Tabu Ley Rochereau est passé par là, Franco jouait régulièrement sur place de même que le Camerounais Moni Bilé ou encore le Gambien Francis Kingsley.
Abidjan était une ville symbole de modernité et d’influences nouvelles qui s’ouvrait au reggae à commencer par Alpha Blondy qui a été un peu le détonateur du succès de la World music. Sa chanson Brigadier Sabari – sortie en 82 – a été l’un des plus grands succès de musique africaine moderne. C’est aussi là que le hip-hop a commencé à émerger. La Côte d’Ivoire – et ensuite le Sénégal – a vu éclore pas mal d’artistes estampillés hip-hop car c’était le pays d’Afrique où l’on importait le plus de disques en provenance de l’étranger. Le reggae, le disco, le hip-hop, la soul, mais aussi le folk y avaient droit de cité. Dans des pays comme le Mali ou la Guinée qui étaient assez enclavés, le marché restait plus limité.
Comment ces nouveaux marchés ont-ils fini par s’ouvrir ?
Ils se sont ouverts avec l’apparition des premières cassettes à Abidjan qui vont peu à peu remplacer le vinyle. Elle marque une nouvelle révolution dans la manière de consommer et d’écouter la musique qui peut alors être copiée rapidement. Avec le vinyle, c’était plus compliqué, il fallait que les pirates soient très organisés et surtout qu’ils aient une usine de pressage. Alors qu’avec une cassette, la forme de duplication à l’infini se révélant possible, l’aubaine est absolue pour les pirates et dramatique pour les musiciens.
Est-ce à cette période qu’ils commencent à se faire connaître en Europe ?
Certains comme Manu Dibango faisait déjà des allers et retour depuis longtemps. Mais le début des années quatre-vingt voit l’arrivée des premiers artistes africains en Europe : Franco à Bruxelles, Salif Keita et Mory Kanté à Paris.
Des villes comme Londres, Bruxelles ou Paris deviennent les » capitales de la sono mondiale » (6). Car au pays, il n’y avait plus de succès commercial possible pour ces orchestres, le piratage ayant tué le peu d’industries du disque qui y subsistait encore ; Et puis les artistes qui avaient été soutenus à leurs débuts par les États, n’avaient plus les moyens d’être rémunérés pour ce qu’ils faisaient. Avec les faillites socialistes de pays comme la Guinée et le Mali – mais on pourrait aussi parler du Bénin – ils n’avaient plus le soutien matériel nécessaire pour poursuivre leur carrière.
Au début, des associations maliennes ou sénégalaises basées en France invitaient les artistes à venir s’y produire puis des producteurs assez astucieux se sont engouffrés dans cette brèche contribuant à l’explosion des musiques africaines en Europe.
Pourquoi ces musiques ont-elles mis tant de temps à conquérir l’Europe ?
Je pense que c’est lié au manque d’ouverture d’esprit des professionnels occidentaux. La curiosité des dénicheurs de talents, des grands labels et des producteurs n’avait pas encore été assez émoustillée.
Quelques musiciens occidentaux comme le batteur et percussionniste anglais Ginger Baker du groupe Cream avait joué avec Fela à Lagos dès le début des années 70. Grâce à leurs connexions hors des frontières continentales, les artistes anglophones comme Fela ou E.T Mensah avaient alors plus de chance de percer à l’étranger que ceux de l’Afrique francophone. King Sunny Adé, chantre de la Juju music au Nigeria, commence à signer avec des grandes maisons de disques.
En France, avant d’avoir du succès, Salif Keita, Mory Kanté ou Youssou Ndour n’étaient connus qu’au sein de la diaspora africaine qui achetait leurs disques auprès de quelques disquaires spécialisés. À Bordeaux, Le Limousin, qui existe toujours, avait à l’époque un catalogue afro impressionnant, essentiellement vendu aux immigrés africains. L’émergence des radios libres a également participé à populariser les musiques africaines en ouvrant les portes à une programmation différente. Le succès en France de Touré Kunda groupe souvent estampillé » gentille variété africaine » a pourtant été révélateur de cette ouverture à d’autres musiques.
Au début des années 80, la crise économique, le piratage, le manque de soutien logistique des États et des mécènes privés ont poussé les artistes à se mesurer à l’international. C’est par exemple le cas d’Alpha Blondy qui avait tenté de faire carrière à New York en ayant pris conscience des possibilités offertes par des pays comme les États-Unis.
Les artistes africains avaient du talent à revendre mais il a fallu que des intermédiaires, des producteurs, des patrons de labels, des managers croient en leur chance et leur donnent les moyens de s’exprimer.
Votre livre est emprunt d’une certaine nostalgie. Vous évoquez un âge d’or révolu qui perdure à travers des figures charismatiques toujours présentes mais différemment. Quel regard portez-vous sur les musiciens des jeunes générations ? D’autres choses aussi fortes peuvent-elles exister malgré un certain formatage de la World music passée par là ?
Il y a certes un certain formatage mais par exemple au Mali, pays assez extraordinaire qui a engendré un grand nombre de révélations, les artistes comme Toumani Diabaté, Ballaké Sissoko ou Bassekou Kouyaté qui ont entre 35 et 45 ans ont su incorporer à leur musique les influences du passé et celles des grands orchestres des musiques d’expression nationale pour en faire quelque chose de très vivant et d’actuel. Même si les enjeux ne sont plus les mêmes, le Mali est en train de revivre un nouvel âge d’or. Il y a eu un creux dans les années 90 mais Bamako est aujourd’hui en pleine effervescence.
La » belle époque » est liée au développement du vinyle dont les premiers sont pressés à la fin des années 50 au Ghana au Nigeria et au Congo. Une décennie plus tard, les pressages locaux se sont développés dans de nombreux pays. Même si le marché restait restreint par un pouvoir d’achat peu élevé et donc des équipements limités, il y avait quand même une petite communauté d’amateurs. La révolution analogique avec le format cassette, puis digital avec le CD et aujourd’hui le Mp3 a modifié beaucoup de choses. Le rapport à l’objet musical a changé, les émotions ne sont plus les mêmes. Le rapport au disque avec cette idée de patine, du toucher de la pochette vinyle est différent.
Je suis nostalgique d’une période que je n’ai pourtant pas connue sans vraiment savoir pourquoi. Il y a un sentiment de regret mêlé de désir et de nostalgie vis-à-vis de choses non vécues mais sublimées et par certains moments transcendées.
Vous travaillez à un nouveau livre 50 ans de musiques modernes au Mali à paraître courant 2010. Est-ce parce qu’il incarne à vos yeux la richesse et la créativité musicales du continent ?
C’est surtout le pays que je connais le mieux et où j’ai pu tisser un grand nombre de liens avec les artistes. J’ai beaucoup étudié sur la discographie des grands orchestres maliens et je consacre deux chapitres au Rail Band et aux Ambassadeurs qui sont restés deux orchestres de référence dans mon livre sur Salif Keita.
J’espère pouvoir inscrire 50 ans de musiques modernes au Mali dans une série qui couvrira aussi la Guinée, le Sénégal et le Bénin.
Cet ouvrage rend compte non seulement de la diversité de la musique malienne mais aussi de l’extraordinaire apport de ses musiciens. En tant qu’auditeur, je suis très sensible aux rythmes mandingues ou aux rythmes bambara. Ceux-ci sont proches des gammes pentatoniques que l’on retrouve dans la musique éthiopienne, sans parler des influences songhaï, touareg, peul que l’on retrouve au Mali. Ce pays offre un condensé de cultures assez extraordinaire.
Il est intéressant de parler non seulement des musiques modernes amplifiées et électrifiées mais aussi des musiques actuelles comme celles influencées par le hip-hop, des musiques traditionnelles des chasseurs du Wassoulou, des ensembles instrumentaux, des grandes divas et surtout des grands solistes. Car le Mali a donné naissance à de grands virtuoses que ce soit au balafon, à la kora ou au n’goni.
Je montre aussi comment les confrontations entre orchestres régionaux ont stimulé les musiciens maliens qui se rencontraient dans des manifestations comme les Semaines nationales de la jeunesse, initiées en 62 ou les Biennales artistiques de la jeunesse qui avaient lieu à Bamako à partir des années soixante-dix. Les huit régions du Mali étaient représentées et ces rencontres permettaient aux orchestres de rayonner à l’échelle nationale et donc de diffuser les différentes cultures du pays. Cela a permis de tirer vers le haut pas mal d’orchestres et d’artistes. S’il y a une telle qualité musicale au Mali c’est aussi parce que la plupart des artistes ont intégré cet héritage d’une grande richesse.
En quoi votre biographie de Salif Keita parue fin 2009 diffère t-elle de celle de Cheick M. Cherif Keïta rééditée en France au même moment (7) ?
Elle peut être complémentaire car nous ne sommes pas sur le même type d’approche. Mon travail est axé sur le processus de maturation du développement artistique de Salif Keita au travers des orchestres marquants de cette période phare des années 70.
Salif en a signé la préface et il m’a raconté son histoire aux cours de longs entretiens. Lui-même comprenait difficilement que l’on puisse s’intéresser 40 ans après à des petits morceaux inconnus du Rail Band, à tel ou tel 45 tours ou savoir où il avait joué en 72. Parce qu’il cherche dans son uvre à aller de l’avant en permanence, il regarde de ce fait difficilement vers le passé. Il se projette toujours dans ses rencontres artistiques, dans l’évolution des technologies qui lui ont permis de tester différents médiums, avec plus ou moins de réussite.
Aujourd’hui il me semble avoir redécouvert les vertus acoustiques de cette grande musique malienne en revenant, avec l’immense talent qui est le sien, au dépouillement et à la sobriété. Cette biographie apporte une forme d’éclairage sur toute sa genèse en tant qu’artiste.
Le travail de mémoire inscrit dans vos diverses démarches semble être le fil conducteur de votre travail que ce soit dans la rédaction de vos livres ou dans les compilations sur lesquelles vous travaillez
J’ai eu la chance d’écrire une quinzaine d’ouvrages depuis 2004 et chaque livre est une partie du puzzle que je suis en train d’assembler.
Le travail de mémoire sur Salif Keita mais aussi sur Ali Farka Touré s’impose mais n’a malheureusement pas été fait au Mali. J’ai donné des conférences à la Faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines de Bamako (Flash) où les étudiants et les professeurs m’ont encouragé à poursuivre mes recherches tant que les témoins de cette époque sont encore là. Les musiques qui appartiennent au patrimoine commun du Mali et aux pays de la sous-région intéressent les gens mais le travail reste à faire. C’est un travail de fourmi qui nécessite d’innombrables écoutes, une grande connaissance de ces musiques et des interactions entre les différentes villes comme Conakry, Abidjan, Bobo-Dioulasso et Bamako où ont eu lieu de nombreux échanges culturels. Il y a bien sûr dans ces pays des gens qui en savent dix fois plus que moi mais qui n’ont pas entrepris de synthétiser toute leur connaissance.
Comment avez-vous accédé aux archives notamment pour L’Épopée de la musique africaine où l’on sent un gros travail documentaire tant au niveau historique que visuel avec la présentation de nombreuses pochettes vinyles ?
Étant un grand collectionneur de vinyles, la plupart des pochettes proviennent de ma collection. Pour le reste, j’ai fait des recherches en France et en Afrique.
Ce livre n’est qu’un panorama mais il m’a permis de dresser, avec des moyens modestes, un état des lieux qui n’existait pas. J’ai eu la chance de faire des rencontres humaines déterminantes dont certaines m’ont permis de resituer tel ou tel détail d’une période déterminée. De nombreux témoins, artistes et collectionneurs sont encore vivants, on peut encore trouver les disques sortis à l’époque, il n’est pas trop tard pour rassembler le plus d’informations possible.
Tout un pan de la culture moderne urbaine africaine est à redécouvrir et cela passe essentiellement par les productions vinyles des années 70 car les années 60 suivaient un autre schéma musical peut être plus calqué sur les musiques d’influence latines, en particulier les musiques afro-cubaines et dominicaines.
Le fait d’avoir été dans les différents pays m’a fait changer en tant qu’individu et m’a donné une volonté de faire tout mon possible pour mieux les faire connaître à travers leurs musiques par le biais de conférences, d’ouvrages, de compilations, de rencontres et même parfois de scènes DJ.
La photo que vous pratiquez semble être un volet important dans votre travail. La considérez-vous comme une activité complémentaire ?
Quand je suis en Afrique, je fonctionne toujours avec l’image et la musique. J’aime beaucoup Malick Sidibé mais aussi Adama Kouyaté qui est pour moi l’un des grands photographes africains oubliés que j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et qui m’a montré ses archives. Influencé par le photographe américain William Eggleston, je reste cependant très attaché à la photo couleur. La photo est un peu une bande-son visuelle de ce à quoi je peux être confronté en voyageant. Je suis autodidacte, j’essaye de prendre des images et tant mieux si certaines fonctionnent. Je ressens un besoin de documenter, de restituer tout ce que je découvre au cours de mes voyages. Je m’attache à des choses fanées, un peu oubliées, aux peintures écaillées, aux endroits décrépis
C’est naturel pour moi dans la mesure où je suis originaire de Bordeaux où subsistent aussi ces images. J’aime des villes comme Lisbonne, Saint Louis du Sénégal, Salvador de Bahia ou la Nouvelle Orléans où perdurent les rémanences d’un âge d’or disparu et des effluves un peu mélancoliques. C’est ce qui me touche aussi dans la photo, cette idée des choses fanées auxquelles on n’attache plus d’importance. Aujourd’hui, c’est le règne du plastique, du lisse, du synthétique, de tout ce qui est beau sans l’être, du triomphe de l’économie sur la mélancolie et sur l’authenticité. C’est pour cela que j’aime autant les musiques et les lieux qui ont une histoire et bien souvent un supplément d’âme.
1. L’épopée de la musique africaine, Rythmes d’Afrique Atlantique, Florent Mazzoleni, ed. Hors Collection, mars 2008
2. Motown, Soul et Glamour, Florent Mazzoleni et Gilles Pétard, ed. Serpent à plumes, oct. 2009
3. Salif Keita, la Voix du Mandingue, ed. Demi-lune, coll. Voix du Monde, oct. 2009
4. Musique de l’Afrique, ed. Horizons de France, Paris, 1969. Traduit en anglais African music : a people’s art, Lawrence Hill & Co. CT 1975
5. Notamment avec la parution en 2003 de Rumba, on the river : A History of the Popular Music of the Two Congo, Gary Stewart, Verso Books, 2003
6. Comme le définissait à l’époque le magazine français Actuel
7.Salif Keïta, l’ambassadeur de la république du Mali,Cheick M. Cherif Keita, publié en 1985 aux éditions du Figuier et réédité en octobre 2009 aux éditions Grandvaux.