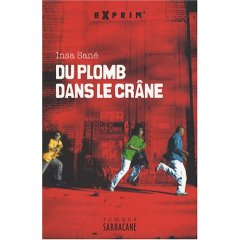Après son premier roman Sarcelles-Dakar (1), Insa Sané vient de publier « Du plomb dans le crâne », aux éditions Sarbacane. Écrivain, slameur et comédien, il sort parallèlement un album éponyme avec son groupe le Soul Slam Band.
« Sarcelles-Dakar », puis du « Plomb dans le crâne » traitent de tous les sujets chauds : banlieue, immigration, violence, crise d’identité
Et le racisme, toujours le racisme, pourquoi ?
Je suis né au Sénégal à Dakar et avant de venir en France, je ne savais pas que le racisme existait. Le choc a été d’autant plus brutal quand je suis arrivé en France, à l’âge de 6/7 ans. La télé m’agressait. Je me souviens d’une émission comme Récré A2
Il y avait par exemple une vache noire qui s’appelait la noiraude et qui était complètement bête, stupide. Et puis il y avait aussi Michel Leb avec ses blagues que je n’ai jamais compris. Quand j’allais à l’école, les enfants m’appelaient la noiraude. À l’époque il n’y avait pas beaucoup de noirs. Résultat je me battais tous les jours !
Comment avez-vous fait vos premiers pas dans l’écriture ?
Mon père était imprimeur, donc à la maison il y avait plein de livres géniaux avec de supers belles illustrations. Je me souviens des recueils de contes de Grimm, de Perrault, des contes d’Asie, d’Afrique, etc. J’essayais de comprendre les mots, j’y allais à tâtons, je revenais dessus. Puis après j’ai accroché sur pleins d’histoires. Je me souviens aussi d’un bouquin sur la mythologie grecque que j’ai lu et relu. Mon père ne me disait pas : « T’as le droit de lire ce bouquin et pas celui-là, celui-là n’est pas de ton âge
» Quand je suis tombé sur « les châtiments » de Victor Hugo, j’ai été transporté ! Là j’ai su que j’avais envie d’écrire des poèmes. Ça m’a accompagné pendant très longtemps. Sans m’en rendre compte, je lisais et j’écrivais des nouvelles, des pamphlets, et puis des poèmes à des nanas
Et maintenant, comment écrivez-vous ? Avez-vous des règles, des horaires, y a-t-il des moments privilégiés ?
J’écris comme je suis. Je suis un hyperactif et je suis un peu bordélique. Du coup je ne me soucie pas de savoir qu’elle est le bon moment pour écrire. C’est toujours le bon moment. En fait, ce n’est qu’une histoire de concentration. L’inspiration, c’est de la connerie. L’inspiration c’est une excuse pour ne pas faire ce que l’on a à faire. Dès fois, ce n’est pas facile, il faut se concentrer pendant deux heures avant que la première phrase vienne, dès fois ça va tout seul.
Il faut juste avoir envie de se concentrer ?
Oui il faut avoir cette envie-là, mais comme je l’ai eu très tôt, c’est presque devenu un besoin pour moi. Parfois je suis même en manque et il faut que je me replonge dans cet état. À part ça, je reconnais qu’il y a des endroits où j’écris mieux. Il y a des moments où le silence aide. Le truc génial ça a été d’écrire au Sénégal « Sarcelles-Dakar », mon premier roman. J’avais plein de problèmes en France. J’étais dans le creux au niveau de la musique (comme le personnage qu’il joue dans « voisins, voisines » de Malik Chibane). Quand je suis arrivé au Sénégal, je me suis dit : « ok c’est bon, la France c’est la France, ici c’est le Sénégal ». C’était magique : d’un coup, je me suis senti super bien. C’est comme si j’étais rentré dans la peau d’un nouveau personnage. Rien à prouver, rien à espérer de la vie mais tout à attendre, surtout du bonheur. Et puis j’étais avec mon meilleur ami dans une belle maison. Il n’y avait que des gens géniaux autour de nous. Quand on voulait s’isoler, on pouvait. Et donc j’écrivais, j’écrivais. J’ai jamais été aussi productif et aussi sain d’esprit. Sain dans ma démarche artistique parce que j’écrivais sans me préoccuper de ce que les gens allaient en penser, si j’allais trouver un éditeur… Alors que je prenais beaucoup de risques : ce livre n’a rien de glamour, je n’ai pas respecté les formats, ni les règles
De quelles règles s’agit-il ?
Habituellement dans un roman, il y a un personnage principal. L’écrivain raconte son aventure du point de vue de ce personnage, même si c’est écrit à la troisième personne. On ne remet pas en question son opinion. Dans « Sarcelles-Dakar », il y a des interludes où des personnages secondaires deviennent principaux. Ils peuvent alors dire des choses que le personnage central ne peut pas dire parce qu’il a son caractère, son identité et son histoire.
Quand vous écrivez, vous avez conscience de ne pas respecter les règles ?
Les règles, j’en ai conscience, je les connais pour avoir lu, pour avoir fait des études, pour m’être posé des questions : « pourquoi tu aimes ce roman, pourquoi tu aimes Victor Hugo, Chester Himes
? » C’est comme ça que j’ai appris les règles. Et puis dans « Sarcelles-Dakar », l’idée de créer des interludes m’est venue du cinéma. Je me suis inspiré d’un film que j’ai adoré : « La cité de dieu ». Dans ce film, il y a une scène géniale avec Zé piquinio qui débarque dans la baraque du dealer pour s’approprier sa maison et agrandir son territoire. Sur cette scène il y a trois interprétations : celle du héros, le photographe, celle de Zé piquinio et celle du dealer. J’ai trouvé ça extraordinaire. Et j’aime l’idée de tordre le coup aux règles parce qu’un artiste c’est d’abord ça.
Je suis étonnée que vos livres soient classés dans les livres « jeunesse ». Quand vous écrivez, vous vous adressez aux jeunes ?
Je m’adresse à tout le monde. Je n’écris pas spécifiquement pour la jeunesse. Ça fait un an et demi que je rencontre mes lecteurs et ils ont tous les visages. Quand j’écris, j’essaye juste d’être sincère. Je me dis que c’est comme ça que j’irais au bout de mes idées et que le lecteur, quel qu’il soit, pourra se reconnaître, s’identifier et apprécier le roman. Quand l’écrivain prend le risque de ne pas être compris, là il devient un artiste et peut créer de nouvelles bases pour pouvoir avancer. Et effectivement je m’inscris dans une littérature jeune parce qu’elle reproduit le chemin des adolescents qui ont envie de créer une nouvelle société, d’aller plus vite pour ne pas être contraint dans un monde vieillissant.
Écrivain de banlieue, pour vous, c’est péjoratif ?
Écrivain populaire, ça me va, écrivain de banlieue, ça n’a pas de sens. Enfin ça a un sens négatif dans le contexte actuel parce que quand on parle banlieue, on parle forcément de noirs, d’arabes, de misère, d’ennui
de toutes les représentations négatives qui servent à enlever toute crédibilité à ce qui vient de là-bas. Populaire, par contre, oui, ça me va parce que les banlieues sont populaires.
C’est-à-dire ?
La culture populaire, celle de la masse, vient de gens qui n’étaient pas censés se rencontrer mais qui se rencontrent quand même et doivent apprendre à vivre ensemble. Et même si au départ ils ne parlent pas la même langue, ils vont faire l’effort de trouver des codes pour pouvoir s’exprimer, se comprendre les uns les autres. C’est le langage des gens qui emmènent une poésie d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et qui mélangent toutes ses poésies pour donner une nouvelle humanité. C’est aussi le fait d’imposer des mots à une culture et à un monde qui résistent. Le dictionnaire français, je suis désolé, ne demande pas de visa pour pouvoir intégrer des mots d’ailleurs, même quand ils viennent de pays ou de cultures décriées. Aujourd’hui on oppose la culture populaire à une culture d’élite. On voudrait que les gamins parlent avec 10 000 mots dont ils n’ont que faire. Si la culture dominante impose ses mots à la culture populaire, ça va être beaucoup plus dur pour les gens de ce monde-là d’accéder à l’élite. D’autant plus que la culture populaire a sa place. Elle est en général à l’origine d’influences. C’est elle qui fait bouger la langue, qui fait vivre les gens du 16e arrondissement de Paris jusque dans les bas-fonds de la France.
Culture populaire et culture de l’élite, c’est aussi une question sociale, non ?
À la base, dans la culture populaire, il n’y a rien de glamour. C’est fait avec les mots du peuple et ça devient drôle, gore, il y a une âme. Aujourd’hui si tu parles d’amour et que tu ne prends pas en compte la réalité sociale, la réalité politique, économique, tu ne donnes pas d’âme à tes personnages. On ne me fera pas croire que les gens ne vivent que d’amour et d’eau fraîche. La littérature pour laquelle je me bats, elle parle d’amour, elle rêve d’amour et d’eau fraîche, mais elle est rattrapée par la réalité et elle compose, avec un certain talent.
Quelles sont vos références littéraires dans l’écriture populaire ?
« Les petits enfants du siècle » de Christiane Rochefort, c’est pour moi un des premiers romans urbains en France. Et puis il y a bien sûr les écrivains américains comme Chester Himes, Iceberg Slim ou encore Lamine Camara avec un mélange de contes traditionnels et d’écriture contemporaine. Populaire, ce n’est pas un endroit, un lieu, mais un mode de vie. On bouffe du cheese burger, on rêve d’Afrique, de plages, de savanes. Populaire, c’est dans la masse, ce sont les envies d’une population qui aujourd’hui est mondiale.
« Du plomb dans le crâne » est un polar social qui se passe à Villiers le bel pendant des émeutes sociales
Vous souhaitez être le porte-parole des banlieues ?
Non, personne ne me le demande et moi non plus je n’ai pas envie d’être le porte-parole « des jeunes de banlieue ». Mais je pense que c’est mon devoir et mon boulot d’écrivain de parler d’eux parce que je trouve qu’on en a très mal parlé à la télé, dans les journaux
J’ai été choqué parce que sur les plateaux il y avait tout le monde sauf ceux qui ont mis le feu. On a la version du politicien, la version du sociologue, de la mère de famille, du père, du voisin à qui on a cramé la bagnole, celle du grand frère, des associatifs
Mais on n’a pas la version du mec qui a cramé. Comment peut-on juger les gens sans avoir entendu leur version des faits ? Mais on ne veut pas entendre ce qu’ils ont à dire parce que ce jour-là, on se rendra compte que le problème est beaucoup plus profond que ça et que le mal-être de ces jeunes est un malaise qui nous touche tous. Ces jeunes ont cramé des bagnoles, ils ont fait plein de conneries, ok, mais ils l’ont fait parce qu’ils devaient le faire sans se poser des questions. Sans se dire que « c’est pour aller vers un monde meilleur ». Ils l’ont fait inconsciemment pour qu’un écrivain comme moi puisse exister, ils l’ont fait pour que leurs petits frères et petites surs n’aient pas à le faire
Aujourd’hui les gens se rendent compte qu’il y a une vie à l’extérieur de la périphérie. Ils se disent : « Ah ! peut-être qu’il y a des écrivains, peut être qu’il y a des chanteurs, ah ! peut-être
» Ils étaient tous là avant, mais on leur donne leur chance aujourd’hui parce que des gamins ont mis le feu. C’est ça la triste vérité.
Ils se sont sacrifiés ?
Oui et sans en être conscients. Ils l’ont fait parce qu’ils devaient le faire comme les Jacques avant la révolution française foutaient le feu à leur champ pour ne pas avoir à filer une partie de leurs récoltes au seigneur. Les révoltes des Jacques aussi étaient considérées comme des crimes, comme de la délinquance. Et ça a donné lieu à la révolution française. Aujourd’hui on est en plein dedans mais les gens ne veulent pas voir ça.
Ces jeunes portent le malaise de l’être humain aujourd’hui, ça veut dire quoi ?
Le malaise vient du fait qu’on a plus d’alternative. Pas d’autres modèles politiques, sociales et économiques. Avant, il y avait le bloc soviétique. Donc quand ici c’était trop dur, on pouvait se tourner vers là-bas, on pouvait imaginer une autre forme de société, même si ce n’était pas le meilleur des mondes, même si c’était un peu un fantasme, on avait quand même le droit de rêver. Les gamins d’aujourd’hui sont nés dans un monde où il n’y a pas de boulot, tout le monde leur dit qu’ils vont en prendre plein la gueule, qu’ils n’auront pas de retraite et qu’il n’y a rien à espérer. Le malaise vient qu’aujourd’hui on ne peut pas regarder nos jeunes. Comment peut-on raisonnablement dire à son petit frère : « travail à l’école, t’inquiète, comme ça, tu vas t’en sortir ». Alors que toi-même t’as travaillé à l’école et que tu t’en ais pas sorti. Quel discours peut-on avoir ? Le malaise vient aussi que l’humanité a tout pour réussir, un monde presque idéal, un monde où les gens pourraient tous manger à leur faim, tous avoir un toit au-dessus de leur tête. Nous avons le pouvoir de créer les bases d’une vraie humanité, mais on ne le fait pas. C’est ça le problème. On n’est jamais arrivé aussi près de ça et on a jamais autant tourné le dos à notre humanisme. Le problème aussi c’est que de plus en plus les gens sont éduqués avec des valeurs qui ne nous permettront pas d’aller vers cet humanisme Quand tu regardes la « Star ac' », « Pop star » où c’est chacun pour sa peau, ça entretient l’idée qu’il ne faut pas que tu aides ton prochain. Voilà c’est ça qui est super triste et qui entretient le malaise.
1. Éditions Sarbacane, 2006