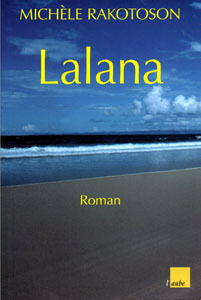Pour faire le deuil du père ou de la mère, Ken Bugul et Leïla Sebbar choisissent la voie romanesque. Michèle Rakotoson aborde la question du sida par le deuil d’un ami.
Le cinquième roman de Ken Bugul surprend. De l’autre côté du regard ressemble à une litanie, une oraison, un chant, chaque phrase étant méthodiquement ponctuée d’un retour à la ligne, comme pour affirmer sa force. Un poème en prose, diront certains.
Cette forme, Ken Bugul l’avait déjà cultivée, dans une moindre mesure, dans ses deux romans précédents, Riwan et La Folie et la mort, parsemés de pans de litanie. Ici, elle l’adopte pour l’intégralité du roman.
Le choix peut paraître à première vue périlleux mais se justifie au fil des pages. En effet, Ken Bugul semble ici avoir trouvé la forme qui correspond le mieux à sa voix et à son style, marqués de digressions, de retours en arrière, de répétitions et d’interjections. Cette forme fonctionne aussi parce que soutenue par le personnage de la narratrice et le sujet du roman : explorer l’histoire familiale et ses jonctions avec l’histoire personnelle.
Au cur de cette histoire, il y a la relation difficile et douloureuse de la mère et de la fille, avec du côté de la fille une question restée à jamais sans réponse : pourquoi la mère est-elle partie, abandonnant sa petite fille ? Aucune explication ne sera la bonne, aucun geste la mère revient par la suite ne pourra vraiment panser cette blessure. L’auteure tente alors de la penser, consignant souvenirs et conversations, comme autant de preuves qui se perdent rapidement dans la nébuleuse de l’histoire familiale : les préférences, les jalousies, les querelles d’enfants dont on se souvient trente ans après et qui ne demandent qu’à être rappelées pour raviver le ressentiment.
Et comme aucune réponse n’émerge, la narratrice convoque la mère décédée pour un tête-à-tête sous la pluie. Le dialogue qui s’en suit semble moins la révélation d’une ultime vérité qu’un rituel de réconciliation et de deuil. Faire le deuil de la mère, serait-ce aussi faire le deuil de ces questions en forme de nud, jamais formulées, jamais satisfaites ?
Cette question, Leïla Sebbar se la pose elle aussi. Je ne parle pas la langue de mon père, intitulé » récit » plutôt que » roman « , pose d’emblée les éléments autobiographiques, avec une courte biographie du père dont il est question dans l’ouvrage. Le père, instituteur dans l’école française coloniale, n’a jamais parlé l’arabe, sa langue maternelle, à ses enfants ou à leur mère française.
Dans le contexte de l’Algérie coloniale, la séparation linguistique est nécessairement marquée par le politique. À un niveau plus personnel, elle représente également une rupture dans la transmission. » Peut-être la langue étrangère l’a-t-elle séparé des mots qu’il aurait choisis pour nous, ses enfants ? » se demande l’auteure à propos de son père. Comment comprendre alors l’histoire familiale, l’histoire de la mère et des surs du père, de toutes ces femmes que Sebbar semble chercher derrière le père ?
Devant le silence paternel, Sebbar choisit, comme Ken Bugul, d’utiliser sa liberté d’écrivain et remplit les blancs de l’histoire familiale par de la fiction. Le résultat est surprenant : autant l’auteure laisse la place aux hésitations pour les parties autobiographiques, autant la narration est affirmée et sans conditionnel quand il s’agit de fiction. Si bien que l’auteure se sent tenue de rappeler à la fin du livre que tel ou tel élément n’est que pure invention
L’acceptation du deuil et la réconciliation, ici, se résume à la dernière page : » Je n’apprendrai pas la langue de mon père. » Car ce n’est finalement pas de langue qu’il s’agit, mais de la rupture fatale ? entre le parent et l’enfant, rupture que la mort vient définitivement confirmer.
Reste une berceuse, qui débute et qui clôt le roman de Ken Bugul, et qui revient discrètement sur la question de la transmission : la narratrice accouche à son tour d’une petite fille, l’auteure dédie son roman à sa fille. La berceuse est tel un fil rouge, un lien entre des générations qui se sont parfois peu connues et peu comprises mais qui partagent une histoire commune.
Histoire commune également pour Naivo et Rivo, les deux protagonistes de Lalana de la Malgache Michèle Rakotoson. Ils ne sont pas frères mais amis. Rivo est en train de mourir, d’une mort lente et honteuse marquée du sceau du sida. Naivo décide de l’extirper de l’hôpital pour lui offrir une fin digne, au bord de la mer. Le roman devient alors un récit de voyage à travers toute l’île.
Le voyage interpelle à plusieurs niveaux. Il sert de prétexte pour mettre en scène la misère extrême qui ravage Madagascar, décrite jusqu’à la nausée. C’est aussi une traversée de la mythologie et de l’histoire, un voyage quasi mystique parsemé de symboles, d’oiseaux de bonne et de mauvaise augure. Voyage dans le temps encore, avec les mémoires et les confidences de Rivo.
Mais c’est surtout un voyage vers la mort, vers les ancêtres, où alternent les moments de lucidité et de délire. Ce voyage vers l’au-delà, Naivo le fait en partie avec Rivo, se laissant entraîner par ses hallucinations. Il souffre quand il ne comprend plus rien, il oscille entre la volonté farouche de sauver son ami et le désir de se laisser mourir avec lui.
Rakotoson aborde ici de façon frontale la question du sida, le tabou terriblement fort qui le marque, malgré le nombre de morts et la présence quotidienne de la maladie. Sa menace plane sur toute relation et influence fatalement la façon dont les jeunes vivent leur sexualité.
Plus subtilement, se glisse la question de l’homosexualité. À travers le regard de Naivo, l’auteure met en scène les préjugés et l’exclusion qui frappent Rivo, tout en introduisant au fur et à mesure du voyage des éléments plus personnels qui amènent Naivo vers un questionnement sur sa propre sexualité. Naivo, assez proche de Rivo pour comprendre et compatir, reste très marqué par le tabou de sa communauté et de sa culture. Le sentiment d’ambiguïté, de dégoût et d’attirance mêlés qui s’en suit est décrit par l’auteure avec beaucoup de finesse.
Curieusement, ici aussi, montent les échos de berceuses, de comptines, de chansons entendues dans l’enfance, comme si l’approche de la mort nous ramenait au début de la vie. Ou est-ce la naissance d’une autre vie ?
Je ne parle pas la langue de mon père, de Leïla Sebbar. Julliard, 2003, 128 p., 15 .
Lalana, de Michèle Rakotoson. L’Aube, 2002, 200 p., 19,50 .///Article N° : 2871